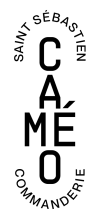Le prix du passage
Entretien avec Thierry Binisti, réalisateur
Quel est le point de départ du Prix du passage ?
À l’origine du projet, il y a l’expérience que la scénariste Sophie Gueydon a eue d’abord à Paris puis dans le Nord de la France, près de Calais. Elle y a passé beaucoup de temps, en travaillant dans des associations, et en nouant des liens avec les migrants qu’elle a rencontrés. Son propre vécu, sur place, nous a été précieux à la fois pour l’écriture et la fabrication du film même s’il a fallu réactualiser le récit après le démantèlement de la « jungle ».
L’histoire s’est développée autour des personnages de Natacha et Walid, qui nous permettaient en quelque sorte de parler de deux mondes totalement différents, de deux univers parallèles qui se rencontrent, voire se percutent grâce à la fiction.
Sophie avait croisé des jeunes femmes comme Natacha ?
Disons qu’il y a une part d’elle dans le personnage de Natacha ; elle est entière et rebelle, souvent à fleur de peau. Quant à Walid, Sami et tous les personnages de migrants du film, ils sont inspirés de gens que Sophie a connus. En préparant le film, j’ai moi aussi, fait des rencontres importantes, aussi bien du côté du tissu associatif que des migrants, qui, pour certains, sont amenés à rester longtemps en France. Ils vivent l’expérience difficile de l’exil en transit, être ici et nulle part en même temps. Être dans l’attente d’un prochain lieu de vie, dans l’espoir d’une solution, d’un passage. Éprouver ce sentiment d’être coincé sur une côte, face à la mer alors qu’ils voudraient aller en Angleterre, pour dans de nombreux cas, rejoindre leur famille. Tout cela a beaucoup nourri le récit.
Quel rôle avez-vous joué dans l’écriture ?
J’en ai suivi toutes les phases, que Sophie Gueydon a élaborées aux côtés de Pierre Chosson, un scénariste expérimenté. Très vite cette histoire est devenue la mienne. Je suis sans doute Natacha et Walid en même temps. Sa colère à elle et le mouvement pour lui. Je connais ce chemin de l’exil à travers l’histoire de mes parents. Cet ailleurs rêvé, et surtout l’arrachement à un monde. Et cette rencontre qui créé cet échange de culture, de vision et de désir. Il y a eu beaucoup de versions du scénario parce que Gilles Sacuto et Miléna Poylo, de TS Productions, sont des producteurs qui croient beaucoup à la maturation de l’écriture. Cela nous a permis de privilégier la force des personnages comme moteur principal du récit et d’aller vers l’essentiel. On a souvent tendance, au début, à avoir des dramaturgies assez complexes, mais si l’on fait confiance aux personnages, si l’on s’attache à ce qu’ils sont plutôt que d’inventer mille rebondissements, quelque chose d’assez fort finit par se dégager. Du coup, le film s’est épuré à l’écriture comme au montage pour se resserrer sur l’essentiel.
Dans quelle ville vit Natacha ?
À cause du sujet du film, cela n’a pas été si simple de trouver des lieux de tournage même si, au final, nous avons été bien accueillis dans des villes comme Boulogne et Dunkerque, entre autres.
Natacha habite une ville qui pourrait être Calais, mais concrètement la barre d’immeubles dans laquelle elle vit est filmée à Boulogne-sur-Mer. C’est aussi à Boulogne qu’on a trouvé notre décor de passage de douane. À Boulogne, des guérites désaffectées subsistaient datant du temps où des hovercrafts faisaient la liaison avec l’Angleterre. Les hovercrafts n’ont pas duré, ce checkpoint n’a quasiment jamais été utilisé, on l’a remis en service et pris pour décor.
Calais reste un point de passage privilégié, mais depuis le démantèlement de la jungle, les migrants sont dispersés sur toute la côte, dans des campements qui peuvent abriter jusqu’à trois cents personnes, souvent regroupées par nationalité.
À la place d’une jungle, plusieurs petites jungles… ?
C’est ce que la police essaye d’empêcher. Tous les deux jours, les CRS obligent les migrants à déménager, parfois juste pour aller cent mètres plus loin. L’essentiel pour les forces de l’ordre est qu’il n’y ait rien de pérenne, aucune infrastructure durable. Les associations font le tour de ces différents camps pour apporter chaque jour de la nourriture, des vêtements et ce dont on a été témoin était souvent extrêmement touchant. Je me souviens d’un couple qui a décidé de laver le linge des migrants. Ils ont installé quatre machines à laver dans leur garage et chaque jour ils collectent le linge dans des sacs plastiques numérotés, le lavent, le sèchent et le rapportent. Leur facture d’eau est colossale mais ils se sont donné cette mission.
Cela va contre l’idée reçue que les locaux sont hostiles ou indifférents aux migrants, comme d’ailleurs l’est Natacha au début du film…
Les deux attitudes existent : le soutien et le rejet… Les camps changent de places constamment, la situation est complexe. Dans notre film, c’est le choc de deux précarités : celle des migrants et celle d’une forme de sous-prolétariat urbain dont Natacha fait partie. La rencontre de ces deux mondes est parfois explosive, car l’injustice des conditions de vie de part et d’autre est criante.
Natacha est, elle aussi, dans une grande précarité économique qui limite totalement son univers et la rend dépendante des personnes qui gravitent autour d’elle. Elle se sent confusément dans un échec constant, avec une impossibilité d’avancer, tout s’oppose à elle. La rencontre avec Walid est une véritable porte qui s’ouvre enfin.
Comment avez-vous construit le personnage de Natacha ? Comme les migrants, elle rêve d’un ailleurs…
C’est une jeune femme qui n’a pas encore trouvé le moyen d’être vraiment une mère. À cause de son instabilité, à cause aussi de sa propre mère qui prend peut-être trop de place mais à qui on ne peut pas en vouloir d’être là et de combler en quelque sorte les manques de sa fille. Son désir est de devenir enfin la vraie maman d’Enzo et aussi d’être une adulte capable d’accéder à son propre désir. C’est le point commun qu’elle a avec Walid : il leur est impossible de se construire ici, il leur faut aller ailleurs, s’arracher à leur situation pour pouvoir exister pleinement. C’est bien l’histoire d’une jeune fille qui va enfin devenir femme et mère grâce à l’expérience assez singulière qu’elle va traverser.
Mais des « passeuses » comme Natacha, cela existe vraiment ?
Il y a eu des cas similaires, plutôt isolés. En parlant avec Walid, Natacha découvre une situation dont elle comprend qu’elle peut tirer parti. Ce qui lui manque, elle peut facilement l’obtenir grâce à un passage. Après, les choses s’enchaînent, elle y prend goût.
Mais c’est aussi un dépassement d’elle, c’est grâce à cette épreuve qu’elle accède enfin à elle-même : c’est peut-être la première fois de sa vie qu’elle a osé une chose aussi folle et l’avoir réussie la galvanise, c’est la première marche vers sa liberté. Si le film s’appelle Le Prix du passage, c’est bien parce qu’en quelque sorte tout le monde « passe », tout le monde accède à quelque chose au cours du processus. Pour Natacha, c’est le prix à payer pour pouvoir sortir de sa condition.
Qu’est-ce qu’elle risque et quel jugement portez-vous sur elle ?
On ne risque pas grand-chose si on est pris une fois avec un migrant dans son coffre. C’est interdit, bien sûr, mais on peut convaincre les juges qu’on l’a fait par altruisme. Mais dès que l’on rentre dans un cycle plus professionnel, dès que l’on tire profit de la situation, cela devient plus problématique. Sur les ferries, les contrôles sont aléatoires, environ une voiture sur cinq est fouillée. On peut passer au travers mais il est clair que les nombreux allers-retours qu’effectue Natacha sont de nature à mettre la puce à l’oreille de la police.
La rencontre avec Walid, son entourage, et plus largement ceux qu’elle fait passer, ce sont de vraies rencontres, qui excèdent la pure recherche du profit et qui la transforment. Je crois que le spectateur aura beaucoup d’affection pour Natacha, qu’il ressentira son désarroi, sa peur, et aussi sa jubilation quand les choses se passent bien. Malgré tout, elle franchit une limite et j’avais besoin d’une sanction - que l’on ne va pas dévoiler !
Et Walid ? Pourquoi un Irakien ?
Il a toujours été Irakien, cela vient des rencontres qu’a faites Sophie Gueydon. Quand on a commencé à préparer le film, le nombre de candidats Irakiens au passage était moins important que celui des Afghans ou des Soudanais mais il y a toujours des Irakiens. Walid était étudiant dans son pays ; il a appris le français, il est beaucoup plus « éduqué » que Natacha. L’amour de la culture française, c’est quelque chose qui se partage à travers le monde, c’est un lien possible entre les personnages. J’en ai eu l’expérience dans ma propre vie, en travaillant dans des centres culturels français à l’étranger. Je me suis rendu compte à quel point, pour les gens qui habitent certains pays, la bibliothèque de livres en français, la petite salle de cinéma sont des havres de paix, des refuges dans lesquels ils viennent s’ouvrir au monde.
Walid ne dit pas ce qu’il a subi en Irak. C’est quelque chose qu’on retrouve beaucoup dans les témoignages des migrants : quand on est dans l’énergie de se reconstruire, on essaye de dépasser sa propre histoire. On sait que Walid était étudiant, et que la contestation naît souvent dans ces milieux-là. On sait aussi que l’arrachement au monde qu’on a laissé derrière soi est une blessure dont on ne guérit pas.
Comment avez-vous choisi Alice Isaaz et Adam Bessa ?
La rencontre avec Alice Isaaz a été déterminante. Je ne lui ai pas demandé de passer des essais parce que je connaissais sa force de jeu. Sa lecture du personnage, sa volonté de l’accompagner, son engagement ont fait surgir une évidence : elle devait incarner Natacha. J’ai mis un peu plus de temps à trouver Walid, mais quand j’ai rencontré Adam Bessa, une grâce a opéré. Il a un charme fou et il y avait chez lui une jubilation à jouer ce personnage. Quand ils ont fait des essais ensemble, il y avait une évidence. Adam est un gros bosseur, très doué, il a d’ailleurs reçu le Prix d’Interprétation de la section Un Certain Regard, au dernier Festival de Cannes, pour son rôle dans Harka.
La douceur de Walid contraste avec l’impulsivité de Natacha…
Oui, Natacha est une fonceuse, il y a une colère en elle, que l’on voit à l’œuvre avec son patron dans le bar, avec Éric, son ex ou même avec sa mère. Elle réussit à se maîtriser en présence d’Enzo mais lui ne trouve pas en elle la sécurité qu’il attend d’une mère et il se tourne vers une grand-mère plus rassurante… Face à elle, la douceur et la détermination de Walid viennent aussi de ce qu’il a traversé. L’expérience que va connaître Natacha va lui permettre de se poser, de se construire. Le film tourne autour de cette grande question : comment trouver sa place dans le monde, à l’endroit dans lequel on vit déjà ou quelque part ailleurs ? Quand pourra-t-on se bâtir un destin ? Natacha y parvient grâce à Walid.
Vous évitez le cliché de la relation amoureuse…
Effectivement, on pourrait attendre une relation de cette nature mais ce qu’ils ont passé entre eux, c’est un contrat, un deal - ils utilisent le mot – pour s’aider mutuellement. Alors, il y a bien une séduction, voire une attirance, qui s’installe peu à peu, mais le film ne va pas jusque-là parce que je pense que cela aurait abîmé cette histoire, cela l’aurait limitée si le but était de s’embrasser à la fin. L’idée était de voir comment deux êtres totalement différents se rencontrent et se trouvent des points communs parce qu’ils sont dans la même situation.
Peut-on savoir ce que lui dit Walid ?
On se doute un peu, d’après la façon dont il s’adresse à elle, qu’il s’agit d’un compliment. Mais j’ai tenu à ne pas le traduire. J’aime bien que l’on sorte d’un film en ayant envie de refaire le puzzle, éventuellement de se poser des questions. En gros, il lui dit qu’elle a une très belle âme, les arabophones l’auront compris.
Avec les différents passages de frontière, vous emmenez le film du côté du thriller, avec des séquences pleines de suspense. C’était l’idée de départ ou c’est venu au cours de l’écriture ?
J’aime bien raconter des histoires de cette façon-là, avec une force dramatique qui permet au spectateur d’être dans l’histoire aussi bien par l’émotion que par la réflexion. Même si le film parle de façon sérieuse de la société. Les passages, les franchissements des différents contrôles de police, sont des images fortes d’un point de vue dramatique et symbolique. Elles ponctuent le récit en offrant des séquences assez tendues que l’on ressent par les yeux et le cœur de Natacha, en étant complètement avec elle.
Vous utilisez plusieurs fois l’image du coffre qui s’ouvre, l’éblouissement qui saisit celui qui y était enfermé... Comme un accouchement ?
A fortiori quand Natacha y récupère un enfant… Pour Natacha, libérer un migrant caché dans son coffre est un geste d’une puissance inouïe. Effectivement, c’est une délivrance, un terme également utilisé pour les accouchements. J’ai testé, je me suis mis dans le coffre pour vraiment ressentir les choses et, sans être le moins du monde claustrophobe, se retrouver dans le noir, dans une voiture qui roule, c’est hyper oppressant. Et à l’ouverture, la lumière, le soleil font un bien fou, ils sont extrêmement réparateurs. J’ai essayé de rendre la folie de cette expérience. Le cinéma est vraiment un bon outil pour ça, pour permettre de ressentir des émotions, mais aussi des sensations. La joie de Sami, par exemple, est spectaculaire et décuplée par ce que l’on sait de lui, le désespoir qui a été le sien….
Vous filmez ces délivrances en plongée du point de vue de Natacha, puis en contre-plongée du point de vue du migrant…
Absolument. J’aime ce plan sur elle dans le soleil. J’aime aussi un autre plan quand Natacha regarde son fils, au moment où elle est sûre d’être arrêtée. Le regard d’Alice, vu par la lunette arrière, me touche énormément. C’est un regard d’adieu. On n’a pas pu avoir ces plans dans la continuité de la scène, à cause de la météo. On les a rattrapés plus tard en bricolant pour surélever le coffre de la voiture, voir le ciel au fond, avec Alice en équilibre sur des cubes... Le paradoxe du cinéma, c’est que même si ce n’est pas gracieux au tournage, le résultat peut être saisissant.
Faire ce film, c’est une forme d’engagement ?
Oui, je voulais bouger notre regard, sortir des pures statistiques : la fiction permet d’abolir la distance entre nous et le monde, qui devient abstrait dans le flot permanent des news. Le cinéma nous ouvre des fenêtres sur des situations bizarrement insoupçonnées, parce que rarement portées par des êtres de chair et de sang. Il peut ainsi contribuer à une prise de conscience. C’est ce que j’avais essayé de faire avec Une bouteille à la mer : quand les gens parlaient d’Israël et de la bande de Gaza, j’étais toujours surpris et à quel point c’était juste un problème politique, jamais incarné par des individus. La non-connaissance de la dimension humaine d’une question politique est parfois stupéfiante et la fiction peut aider à remplir ce vide.
(Dossier de presse)