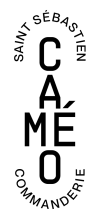Si tu es un homme
Entretien avec Simon Panay, réalisateur
Après votre court-métrage Ici, personne ne meurt (2015), tourné dans une mine d’or au Bénin, vous plongez votre caméra dans la mine de Perkoa au Burkina Faso. Pourquoi avez-vous choisi de renouer avec ce décor minier ?
J’ai réalisé tous mes films en Afrique de l’Ouest et c’est pour ainsi dire là-bas que j’ai appris à faire des films au côté de documentaristes comme Souleymane Drabo, à qui je dois beaucoup. J’ai vécu une bonne partie de ma vie d’adulte au Burkina, que je considère comme mon deuxième pays. Pour mon troisième documentaire, j’ai en effet découvert le monde des mines d’or artisanales, et c’est un monde qui m’a particulièrement fasciné. Plonger dans cet univers artisanal, en compagnie des orpailleurs de la mine de Perma, au nord Bénin, m’a permis de comprendre ce qui m’échappait: leurs mentalités, leurs croyances, leurs motivations, pourquoi certains restent et d’autres partent. Mais le tournage a été arrêté au bout de huit jours par les autorités qui nous ont confisqué notre matériel. Il y avait de la corruption autour de cette mine illégale et beaucoup d’accidents mortels.
Le projet a donc été écourté mais je voulais continuer à travailler sur ce sujet et particulièrement sur les enfants dont la présence m’avait le plus marqué. En descendant dans les galeries souterraines, j’avais croisé un gamin qui devait avoir 8 ou 10 ans. Je suis rentré en France avec son visage en mémoire, le revoyant à chaque projection en festival. Nous ne pouvions pas retourner dans cette mine-là, à cause des problèmes d’autorisations. J’ai donc décidé de privilégier un tournage au Burkina Faso où j’avais déjà tourné deux documentaires. C’est un pays que je connais bien, où j’ai des attaches et un historique. La bourse de la Fondation Lagardère m’a permis de faire des repérages. J’ai visité une dizaine de mines dans tout le pays. Ce projet de recherches photographiques était surtout un prétexte pour trouver un personnage, ce qui s’est produit après quatre semaines de voyage.
Quelles ont été les circonstances de votre rencontre avec Opio ? Quelle a été votre méthode pour faire accepter la présence de la caméra auprès de sa communauté ?
Mon projet photographique m’a permis d’engager le dialogue avec des travailleurs de la mine de Perkoa. Je leur ai demandé s’ils acceptaient que je les photographie. Opio travaillait avec son équipe d’orpailleurs sous une tente et passait les poussières sur un tapis pour trouver des traces d’or. C’était le plus jeune du groupe. Les autres avaient 18-20 ans. Je me suis adressé au plus âgé, comme le veut la tradition en Afrique. Mais j’ai été extrêmement étonné que tous se tournent vers Opio pour avoir son approbation ou pas sur le fait d’être photographiés ! Au Burkina, c’est le plus âgé qui décide en général.
J’ai alors découvert le charisme naturel d’Opio et quelque chose de vraiment électrique et d’intense dans son regard. J’ai compris en moins de cinq minutes que j’avais trouvé mon personnage. Se faire accepter prend du temps, j’ai commencé par aller voir tout le monde sans caméra. J’ai passé du temps avec les autorités locales, la gendarmerie et toutes les institutions ainsi qu’avec les chefs de tradition. Nous avons entrepris un travail de pédagogie pour que tout le monde comprenne pourquoi nous étions là et afin qu’il n’y ait pas de fantasme autour de notre présence. Nous avons tout déconstruit pour partir sur des bases saines.
Le milieu de la mine est difficile à pénétrer, beaucoup de croyances et de superstitions l’entourent. L’étranger peut apporter le mauvais œil. Il était essentiel de gagner la confiance de tout le monde, sans quoi nous risquions de nous faire chasser du jour au lendemain. Entre le moment où j’ai rencontré Opio et la fin du tournage, il s’est écoulé deux ans.
Aviez-vous une ligne de récit prédéfinie ou s’estelle construite au fil des voyages ?
Je m’efforçais d’avoir peu d’attentes précises parce que je voulais vraiment laisser un maximum de place au film et avant tout trouver un personnage fort, plus qu’une situation particulière.
Mais évidemment, j’avais réfléchi à une ligne narrative potentielle. J’ai toujours eu en tête ce rite de passage à l’âge adulte, symbolisé par la plongée dans les galeries souterraines. A la surface, il y a le monde des enfants et dans les souterrains, celui des adultes. Quand j’ai rencontré Opio, je cherchais un enfant proche de ce passage en termes d’âge. J’avais même envisagé la possibilité que des enjeux éducatifs se greffent là-dessus mais nous nous sommes laissés porter par les événements.
Etiez-vous seul au cadre et à la lumière ?
J’ai pris en charge le cadre et la photographie et nous étions en moyenne deux ou trois sur le tournage. Souleymane Drabo, qui est un ami documentariste de longue date, s’occupait du son et Alison Pilorge s’occupait avec Imelda Kanzame de traduire l’intégralité des rushs en français, ce qui fut un travail titanesque. Notre façon de faire a été très artisanale, à l’image du travail que nous filmions.
Vous travaillez beaucoup la profondeur de champ pour inscrire vos personnages dans le décor, tout en déplaçant le point de vue régulièrement. Pourquoi ce parti pris formel ?
La question du point de vue m’intéresse beaucoup et il me semble que selon l’endroit où l’on place la caméra, on exprime des choses différentes. La profondeur de champ a alors du sens. Dans la scène où la famille d’Opio est réunie par exemple, je cherche en permanence sur qui focaliser mon attention. Est-ce sur celui qui parle ? Ou sur Opio qui n’écoute pas ? J’aime la contrainte d’une focale fixe et d’une petite profondeur de champ car ce dispositif oblige à prendre continuellement des décisions de cinéma. J’ai tenté, à travers ce procédé, d’immerger le spectateur dans la scène et lui donner l’impression qu’il fait partie du triangle de discussion.
Comment avez-vous abordé le travail sur la lumière naturelle qui restitue la vivacité des couleurs et le soleil écrasant qui accable les jeunes travailleurs ?
Le travail photographique de Sebastião Salgado m’a beaucoup influencé et poussé vers le documentaire. Nos esthétiques sont différentes mais je trouve qu’il y a quelque chose de puissant dans l’utilisation de la lumière naturelle. Il ne me semble pas utile de rajouter des artifices comme des réflecteurs pour aller chercher la beauté dans une image. Nous nous sommes juste adaptés aux ombres, au soleil, aux reflets, aux éléments du décor, aux visages. Là où on ne pourrait voir que de la misère, j’ai essayé de transcender le réel et en montrer toute la grâce, la joie.
La scène d’ouverture nous place dans le sillage d’Opio. Reflète-t-elle votre parti pris de suivre votre personnage où qu’il aille, y compris dans le trou de la mine, à 250 mètres sous terre ?
Suivre Opio partout a toujours été dans mes intentions. Mais cette scène avait pour ambition de présenter le personnage et c’était selon moi la meilleure manière de le faire. D’une certaine façon, Opio pousse le cadre et ouvre le chemin. Il maîtrise son environnement, son espace. Il y est à l’aise et connaît tout le monde. La mine est un endroit hostile mais aussi le lieu où il a ses repères. Cette scène d’ouverture évoque un personnage en pleine maîtrise de son destin.
Votre film s’ouvre et se referme sur Opio qui évolue dans le décor de la mine. Est-ce une manière de montrer qu’il n’a pas réussi à avancer dans son projet, qu’il est revenu au point de départ ?
Il y a forcément un peu de cette idée d’un retour à la case départ. Dans ces deux plans qui se répondent, il y a une différence de profondeur de champ. Au départ, j’ai détaché Opio du décor : il est net et son environnement est flou. A la fin, il est complètement inséré dans le décor. Je crois que ce plan reflète mon sentiment en fin de tournage : j’avais l’impression qu’il ne s’en sortirait jamais, qu’il était trop absorbé par cet univers pour pouvoir s’en détacher.
La première fois qu’Opio plonge dans les galeries, il a une caméra embarquée. Pourquoi avez-vous tenu à l’équiper avec ce dispositif ?
C’était la première fois qu’il descendait et dans le film, je suis toujours très proche de lui physiquement. La caméra n’est jamais à plus d’un mètre ou deux d’Opio. Je me suis dit que pour cette première descente, j’avais envie de rester près de lui. Je lui ai donc fixé une petite caméra. J’ai été surpris qu’il me confie sa peur de descendre dans les trous. Le monde des mines est un milieu très viril. Il faut montrer qu’on n’a pas peur, qu’on est fort. Pour autant, quand il descend la première fois, il chante, il tire la langue à la caméra. Il a des réactions très enfantines et touchantes.
Pourquoi avez-vous décidé de vous immerger avec Opio dans les galeries, malgré le danger ? En quoi était-il important de l’accompagner ?
Quand on documente une réalité, je crois qu’il est important d’aller jusqu’au bout. Cela ne me paraissait pas pensable de rester en surface, de mettre une caméra sur la tête d’Opio et de me contenter de récupérer les images. Il fallait qu’on ait cette même dimension de cinéma et de point de vue qu’on a à l’extérieur. Le problème de la GoPro posée sur la tête [caméra munie d’un stabilisateur], c’est qu’elle donne un point de vue très impersonnel. Il a toujours été évident que si Opio était amené à descendre dans les galeries souterraines, je le suivrai, même si c’était difficile. L’endroit est exigu, il y a plein de boue et pas de lumière. On a continuellement peur qu’il y ait des effondrements. A la mine de zinc, d’à côté, il y a eu un effondrement trois mois après la fin de notre tournage. Huit mineurs sont morts dans les galeries. Le cinéma est un vecteur qui peut amener du changement. C’était donc essentiel de documenter la vie de ces enfants car à travers eux, on raconte le destin de milliers d’autres.
La scolarisation des enfants en Afrique noire est au cœur de votre film. Malgré les programmes éducatifs, on se rend compte que peu de familles sont en mesure d’envoyer leurs enfants à l’école...
L’école élémentaire est gratuite dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest. Mais cela représente quand même un investissement pour les familles. Acheter des livres et des fournitures scolaires a un coût. C’est aussi un manque à gagner pour les familles car quand l’enfant va à l’école, il ne travaille pas aux champs par exemple. La plupart des familles ne peut pas se le permettre. Depuis 2014, le Burkina Faso est touché par l’insécurité et près de la moitié des écoles du pays sont désormais fermées. Dans les zones tenues par les groupes djihadistes, il n’y a plus d’école depuis de nombreuses années. L’éducation devient un luxe et cela ne va pas dans le bon sens. Le pays s’enfonce de plus en plus dans l’instabilité.
La tradition veut que les enfants soient des soutiens de famille. Opio est renvoyé constamment à ses devoirs envers la sienne.
Opio est allé à l’école jusqu’en CE1-CE2. Son père s’est remarié et a eu des enfants avec sa nouvelle femme. Devant tant de bouches à nourrir, Opio a estimé qu’il était de trop. Il a décidé de devenir autonome financièrement et de partir à la mine. Mais en même temps, il a eu le sentiment d’être chassé de la maison, de ne pas vraiment avoir eu le choix. Ses parents n’ont pas la même version. La mère dit que c’est Opio qui est parti. Quoiqu’il en soit, il a très vite compris la responsabilité de devenir un homme et de ramener de l’argent à sa famille.
Votre film donne à voir la complexité de l’organisation d’une société séculaire, les conditions de travail intolérables mais aussi les addictions à l’alcool ou au cola. En quoi était-il nécessaire de capter ces scènes ?
J’aime bien essayer de comprendre les situations et les rapporter sans les juger. Je ne me sens pas légitime à poser un regard critique sur ce que je vois, ni à définir ce qui est bien ou mal. C’est parfois le piège quand on fait du documentaire en Afrique. J’aime ce point de vue de l’étranger qui ne connaît rien, qui découvre et a tout à apprendre. On prend moins le risque de se tromper quand on assume de ne rien connaître. Le vrai danger est d’amener une morale. Je veux laisser la possibilité à chacun de faire son propre chemin avec le film.
Pourquoi avoir inséré des cartons qui ont valeur d’ellipses dans le film, en plus des commentaires d’Opio en voix off ?
J’utilise en effet deux cartons qui apportent des informations que nous n’avons pas à l’image. Je ne souhaitais pas reconstituer ces scènes comme celle où le père demande à Opio de travailler pour financer sa scolarité. Il ne tenait sans doute pas à ce qu’on en soit témoins. Mais ces informations étaient importantes pour le spectateur. Le carton de fin permet de savoir combien d’argent Opio a réuni avec ses sacs de cailloux et à combien de temps de scolarité cela correspondait, en l’occurrence, à un trimestre.
Quant à la voix off, je l’ai enregistrée la première semaine où j’ai rencontré Opio. J’ai profité de ne pas le filmer pour enregistrer sa voix. J’ai utilisé ce matériel au montage pour présenter le personnage mais aussi exprimer ses peurs. Qu’est-ce que le trou représente pour lui ? Ses paroles sont assez fortes et permettent d’appréhender le mythe associé aux souterrains.
Vous filmez les scènes de transaction à la dérobée. Pourquoi sont-elles beaucoup plus heurtées et brutes que les autres séquences ?
Ces scènes étaient très compliquées car filmées de nuit sur le marché où il n’y a pas de lumière. Opio se déplace toujours en courant et il faut pouvoir le suivre avec le matériel ! Les tentes où se font les négociations sont très petites et Opio venait accompagné de ses amis pour pouvoir négocier en force. On devait trouver notre place au milieu. Je prends les scènes comme elles viennent car je ne peux pas demander aux protagonistes de se placer autrement pour que je puisse filmer. Parfois, je dois porter la caméra à bout de bras et j’ignore si l’image est nette ou floue. C’était un tourbillon de gamins, associé à l’excitation pure d’avoir de l’or entre les mains et de le convertir en argent. Ils couraient de baraquements en baraquements, se retrouvaient avec 2000 francs CFA, alors qu’ils en attendaient au moins 3000... Ils accusaient les vendeurs de trafiquer leurs balances.
Vous accordez beaucoup de place à la parole et aux négociations dans votre film...
La tradition africaine du palabre est passionnante avec ses doubles, voire ses triples niveaux de lecture dans les conversations. C’est un jeu, une façon déguisée de négocier. Les interlocuteurs utilisent des cordes sensibles, évoquent les dieux pour baisser un prix et arriver à leurs fins. Nous filmions des scènes dont nous ne comprenions la teneur que quelques semaines plus tard, après avoir posé les sous-titres. Pour les Gourounsi (qui peuplent la région de Sanguié) l’or n’est pas un métal mais un animal, une sorte de bête mythologique qui vit et se déplace. De sorte que le mineur n’est pas simplement un orpailleur, c’est aussi un chasseur. L’or se nourrit de sang et quand il y a un effondrement, c’est autant une bonne nouvelle qu’une mauvaise. Le sang va nourrir le filon et le faire grossir, la richesse n’en sera que plus grande. Tous ces paradoxes sont fascinants. Il existe aussi une économie parallèle autour de l’or pour attirer la chance. Ceux qui s’en sortent le mieux sur la mine sont assurément les vendeurs de grigris ! L’or est un piège, c’est addictif car c’est la seule chose qui offre potentiellement un avenir radieux.
Vous êtes-vous posé la question d’aider le jeune garçon à payer ses frais de scolarité ?
C’est une question légitime qui renvoie le documentariste à son éthique et à sa philosophie. Dès le départ, nous avons été clairs avec Opio, ainsi qu’avec sa famille et sa communauté. Même s’ils ne nous ont jamais rien demandé. Le rôle du documentariste est de restituer une réalité sans l’édulcorer et évidemment quand cela dure des mois, c’est difficile. Regarder Opio casser ses sacs de cailloux, ne rien gagner et voir son rêve d’aller à l’école s’estomper tous les jours n’était pas simple. Mais j’avais une responsabilité vis-à-vis du réel. Même si j’ai réalisé un film qui n’est ni humanitaire, ni militant, Opio est le porte-étendard de ces 80 millions d’enfants dans le monde qui travaillent dans des conditions difficiles. Dans la temporalité du film, je n’avais pas le droit de l’aider.
Mais une fois le film achevé, on ouvre un nouveau chapitre et je pose ma casquette de documentariste. Je suis juste un individu, sans fonction, ce qui nous permet aujourd’hui d’aider Opio, avec nos moyens.
Pour la sortie du film en salles, nous mettrons en place une cagnotte Leetchi pour celles et ceux qui souhaiteraient lui venir en aide financièrement, pour lui permettre de développer une activité de transport pérenne, en transportant par exemple les sacs de cailloux des orpailleurs ou bien des outils. Cela n’est qu’un exemple de projet à construire avec lui, en fonction de ses envies et aspirations. Si la somme récoltée va au-delà du projet, nous ouvrirons un compte en banque à son nom, dont il pourra bénéficier à sa majorité.
Je rêve de pouvoir soutenir également sa communauté avec un projet de développement plus global. Nous avons des partenariats avec des ONG qui visent à assainir la filière de l’or et du diamant, tenue pour moitié par des groupes djihadistes au Burkina Faso et dans laquelle beaucoup d’enfants travaillent.
La mine d’or de Perkoa pourrait devenir un exemple de possibilité de changement. C’est une mine légale mais dans laquelle les orpailleurs travaillent dans des conditions intolérables et ne sont pas rémunérés correctement. Je rêve d’y instiller un changement positif et durable et nous œuvrons en ce sens.
(Dossier de presse)