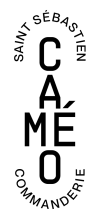C'est mon homme
Entretien avec Guillaume Bureau, réalisateur
Quel a été le point de départ du film ?
Deux faits divers m’ont inspiré cette histoire. Le premier a passionné l’Italie des années 20 durant de nombreuses années. Au fil d’incessants procès, deux femmes se sont disputées l’amnésique de Collegno. Toutes deux prétendaient qu’il était leur mari, soit un respectable professeur, soit un typographe collectionnant les maîtresses, condamné à la prison par contumace.
Le second s’est déroulé dans les mêmes années en France. Un long feuilleton judiciaire a opposé plusieurs familles autour du
« soldat inconnu vivant », un soldat amnésique retrouvé sur un quai de gare. Quand sa photo paraît dans la presse, il incarne immédiatement une figure à travers laquelle des centaines de familles meurtries vont identifier un frère, un fils, un père disparu durant la Grande Guerre. Il faut savoir qu’après-guerre, 300 000 soldats environ sont déclarés disparus. Ce sont autant de familles incapables de faire leur deuil.
Celles qui réclamaient le « soldat inconnu vivant » croyaient sincèrement retrouver leur proche disparu. Elles étaient prêtes à nier les différences physiques.
Cela veut-il dire que lorsqu’on veut croire, il n’y a pas de preuves contraires ?
C’est ce qui m’a touché dans ces faits divers, l’identité n’est pas seulement une affaire de preuves ou de science, mais bel et bien une affaire de croyance.
À partir de cette matière, je n’ai pas voulu faire un film historique mais plutôt raconter une histoire d’amour hors du commun entre deux êtres traumatisés, chacun à leur façon, par la guerre. En aimant Julie, l’amnésique retrouve une identité. Quant à Julie, elle soigne un deuil pathologique. Envers et contre tous, elle décide de croire que l’amnésique est son mari. Car croire que cet homme revenu d’entre les morts est Julien Delaunay, l’aimer, c’est la seule façon qu’elle trouve de rester vivante.
Mais qui aime-t-elle ? Son mari ? Le souvenir qu’elle en a ? L’amnésique ? L’être qu’elle recrée avec lui ? C’est la question centrale du film.
Parmi les éléments de fiction, il y a les univers artistiques dans lesquels évoluent les deux femmes. Qu’est-ce qui a motivé ces choix ?
Julie Delaunay, qu’incarne Leïla Bekhti, est photographe. J’ai choisi cet univers parce que la photographie est le médium du souvenir par excellence. J’avais aussi envie de montrer une femme, en 1920, à la tête d’un studio photo, exerçant un métier plutôt destiné aux hommes. Cela montre déjà qu’à la fin de la guerre, la société commence à évoluer.
Faire de Julie une photographe, c’est aussi en faire une metteure en scène. On le voit dès la première séquence avec les jeunes mariés que Julie dirige comme des acteurs. On le voit ensuite et surtout, quand avec l’amnésique, elle reconstitue les moments marquants de leur vie amoureuse. Elle lui propose une sorte de jeu : « Faisons semblant, l’amour viendra ». Le studio photo devient alors un véritable « théâtre de la mémoire ».
Le studio photo est un monde d’illusion tout comme le cabaret. J’ai choisi cet univers par goût pour les paillettes et le music-hall mais aussi parce que c’est un espace évidemment théâtral. C’est un endroit où l’on se déguise, où l’on joue la comédie et où l’on se met en scène. Cela faisait écho avec la situation de l’amnésique qui, sous le regard de Julie puis de Rose-Marie, joue deux rôles différents.
Cela renforce l’idée d’une manipulation possible de la part de ces femmes…
Tout à fait. C’était un des atouts de cette histoire : allier la romance au suspense.
Le récit s’ouvre de telle manière que l’on croit Julie : les preuves qu’elle apporte suffisent à convaincre le psychiatre de lui remettre son mari et l’homme la croit parce que son amour paraît sincère. Mais lorsqu’une autre femme surgit avec de nouvelles preuves, il y a tout lieu de penser que la première a peut-être menti. À partir de là, j’ai veillé à tenir le spectateur en haleine en jouant sur les deux tableaux et en donnant, des deux côtés, les pièces nécessaires à reformer un puzzle. Cette ambivalence permet à chacun de se faire sa propre idée sur l’identité de l’amnésique. Et le doute peut toujours subsister.
C’est mon homme est un film où le désir fait la loi. A la fin, l’amnésique s’émancipe de la vérité édictée par les institutions judiciaire et psychiatrique. Il dit : « C’est moi. » Mais qui est- ce ? Ça n’appartient qu’à lui… L’enjeu du film n’est pas tant de redonner une identité à un homme, que de lui rendre une âme. Seul l’amour le peut.
En quoi les différents milieux sociaux de ces femmes jouent-ils un rôle ?
Le récit se cristallise autour de cette question : laquelle des deux femmes l’amnésique va-t-il choisir ? Même si l’amour, probablement, ne peut jamais être désintéressé ou décorrélé de tout ce qui entoure (et constitue) l’être aimé, je ne voulais pas que l’argent devienne un critère de choix déterminant. J’ai donc cherché un pied d’égalité entre les deux personnages féminins. Julie vient d’un milieu bourgeois et aisé mais Rose-Marie a gagné des fortunes grâce à la guerre. Toutes deux règnent sur leur univers respectif, studio photo et cabaret. Ce sont des femmes émancipées et autonomes. Elles n’ont pas fondamentalement besoin d’un mari mais ce sont des amoureuses.
À partir de là, j’ai trouvé intéressant de casser les clichés. Julie est celle à qui l’on ferait plus évidemment confiance. Rose-Marie, évoluant dans le milieu de la nuit où les femmes sont considérées comme vénales et volages, inspire la méfiance. Or, le film révèle l’inverse.
Du point de vue de la mise en scène, j’ai choisi les univers de ces deux femmes, pour leur cinégénie. J’ai pensé l’obscurité du cabaret en opposition à la grande luminosité du studio photo. Ces deux femmes incarnent le jour et la nuit.
Comment avez-vous composé le casting de votre trio ?
La première personne que j’ai choisie est Karim Leklou. Lors des essais filmés, il m’a bouleversé.
inquiétante étrangeté, un visage ouvert à toutes les interprétations, une blessure dans le regard. Ses yeux sont un gouffre. Karim provoque une empathie considérable. On a envie de le soigner et de l’aimer. Il incarne à merveille cet homme qui a trop manqué, indéchiffrable, fragile mais plein d’une violence rentrée.
Avec Louise Bourgoin, la rencontre s’est faite autour des chansons. Louise avait très envie de vivre cette expérience au cinéma : chanter et danser. Nos échanges ont été très bénéfiques pour le scénario. Ils m’ont amené à écrire des scènes que je trouve très fortes, comme celle où par amour, elle est prête à rendre sa liberté à l’amnésique.
Quant à Leïla Bekhti, elle est arrivée sur le projet peu de temps avant le tournage. Je n’avais pas pensé à elle d’emblée car on la connait davantage dans le registre de la comédie. Mais ça a été un coup de foudre. Notre rencontre s’est faite autour de Julie. Quand Leïla m’en parlait, j’avais l’impression qu’elle la connaissait depuis toujours comme si Julie l’habitait. Dans ses yeux, brillait déjà le feu dévorant de l’amour fou. Leïla rêvait depuis longtemps d’incarner un rôle de grande amoureuse, prête à tout pour son homme. Et là aussi, notre rencontre m’a permis d’apporter beaucoup au scénario. Inspiré par Leïla et notre goût commun pour la comédie romantique, j’ai davantage développé les séquences de reconstitution des souvenirs dans le studio photo.
Par ailleurs, Leïla est une actrice très populaire qui suscite l’immédiate adhésion du public. Le personnage de Julie nécessite cette adhésion puisque plus le film avance, plus on en découvre le côté sombre.
Et comment avez-vous choisi les rôles secondaires ?
Jean-Charles Clichet, qui incarne Antoine, le frère de Julien Delaunay, montre une certaine ressemblance avec Karim Leklou. Acteur de comédie, il apporte de la douceur à ce personnage que je ne voulais pas cataloguer de manière univoque, dans le rôle du « méchant ». C’est un personnage solitaire qui cache un lourd et pathétique secret. Il est amoureux de Julie. Jean-Charles n’a pas besoin de mots pour l’exprimer. C’est ça qui est fort et bouleversant.
Quant à Ghislain de Fonclare, c’est un comédien de théâtre avec qui je travaille depuis longtemps puisqu’il a joué dans tous mes courts-métrages. Je le savais capable d’apporter une grande humanité au rôle du psychiatre. Je ne voulais pas qu’il ait la rigidité que l’on voit souvent chez les médecins de films d’époque. Le docteur Gramont exerce avec tout ce qu’il est, un homme qui lui aussi a sans doute connu la guerre et perdu des proches. Jouant un rôle pivot, il est celui qui croit, l’une puis l’autre femme.
Quels films ont-ils pu être des sources d’inspiration ?
Choisir de faire un film en costumes comme premier film, c’est un pari ambitieux mais risqué. Mon premier souci était de ne pas réaliser un film figé dans la reconstitution scrupuleuse de l’époque. C’est cela qui m’a guidé dans ma recherche de références à partager avec mon équipe. Je peux ainsi citer des films aussi différents que L’histoire d’Adèle H de François Truffaut, Bright star de Jane Campion, Magic in the moonlight de Woody Allen ou Phoenix de Christian Petzold. Leur point commun, c’est de dépasser la problématique de la reconstitution pour recréer un univers esthétique qui leur est propre.
Mais l’une des principales références qui nous a guidée avec Catherine Jarrier, la cheffe décoratrice, et Colin Lévêque, le chef opérateur, est picturale. C’est l’œuvre de Vilhelm Hammershoi. Ce peintre danois du début du XXe siècle, est d’une étonnante modernité. Ses tableaux nous ont permis d’imaginer une reconstitution de l’époque sobre et minimale. Les intérieurs sont quasiment vides. La fonction des pièces est seulement suggérée par de rares meubles et accessoires. On sait qu’on est en 1920 mais dans les images, il y a une forme d’intemporalité.
Les actrices de l’âge d’or hollywoodien ont joué un rôle fondateur dans ma cinéphilie et mon envie de faire des films. C’est pourquoi dans la lumière, je voulais retrouver le glamour de cette esthétique. Avec Colin Lévêque, on s’est entendu sur une image qui mette en valeur la photogénie des acteurs mais aussi sur le désir de réaliser un film ample et romanesque, d’où les nombreux mouvements d’appareil.
Comment avez-vous travaillé sur les costumes ?
Avec Nathalie Raoul, la cheffe costumière, on voulait des vêtements vivants et qui aient une histoire, d’où notre choix d’aller vers des costumes qui ont déjà une certaine patine.
Pour le personnage de Julie, Nathalie s’est inspirée de femmes artistes et avant-gardistes des années 1920, comme Lee Miller, Berenice Abbott ou Virginia Woolf. Cela nous a permis de vêtir Julie de manière moins conventionnelle que les femmes bourgeoises de son époque. Julie porte des robes sans entrave. Elle s’est réappropriée quelques pièces du vestiaire masculin.
À l’inverse, la silhouette de Rose-Marie est extravagante et baroque. Les costumes de Louise Bourgoin sont directement inspirés de l’univers du cabaret des années 20. J’avais demandé à Nathalie, des plumes, de la fourrure et du strass. Avec Anne Bochon, la coiffeuse, on a imaginé différentes perruques pour les numéros chantés. Tout le travail autour de ce personnage était un véritable terrain de jeu.
Quant à l’amnésique, le nombre de ses costumes est volontairement réduit. Il porte le plus souvent l’uniforme de l’asile, celui des anonymes. Mais il n’a qu’un costume quand il est Julien, et un autre quand il est Victor. Le costume joue un rôle signifiant, indiquant l’évolution du personnage.
Où avez-vous tourné ?
En Bourgogne et en Pays de la Loire. Je vis dans la Nièvre. J’ai tourné non loin de chez moi, à Avallon, dans des décors que je connaissais déjà comme la maison des Delaunay, la collégiale Saint-Lazare ou l’Abbaye de Moutiers-Saint-Jean où a été reconstitué l’asile. En Pays de la Loire, nous avons investi plusieurs châteaux pour les intérieurs, aménagé le studio photo dans une faïencerie de la Sarthe. Après avoir longuement cherché le décor du cabaret, nous avons trouvé par miracle à La Flèche, un théâtre de poche à l’italienne étonnamment situé au premier étage de La Halle aux blés et dont les derniers aménagements datent de 1923.
Quelles étaient vos exigences en matière de musique ?
J’avais envie d’une musique orchestrale aux tonalités lyriques assumées, une musique qu’on se remémore en sortant de la salle, comme un refrain. Mon idée était qu’à partir de ce thème, soient déclinés les différents morceaux de la musique du film. En Romain Trouillet, j’ai trouvé le compositeur idéal pour concrétiser cette envie. Lorsque j’ai démarré le tournage, Romain avait déjà composé le thème principal. C’était un atout car cela donnait, d’emblée, une couleur à certaines séquences.
L’autre partie du travail concernait les musiques de cabaret et surtout, les chansons de Louise Bourgoin. Louise interprète un classique de la Belle Époque, Fascination, mais également une chanson méconnue de Marie Dubas, L’amour est un jeu. Pour la troisième chanson qui intervient à un moment-clef du film, Romain a sollicité Renan Luce qui a écrit des paroles tout spécialement pour un tour de chant incluant un numéro de lancer de couteau : Je sens bien que je vous plais. Pour l’accompagner, Romain a composé dans l’esprit de l’opérette, teinté de quelques harmonies plus riches et novatrices pour l’époque.
(Dossier de presse)