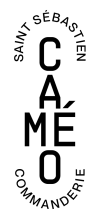A mon seul désir
Entretien avec Lucie Borleteau, réalisatrice
Votre récit débute comme un conte envoûtant, puis instaure une distanciation par un regard caméra. Un peu à la manière d’une séance À l’image, j'ai eu la joie de retrouver Alexis Kavyrchine, après Chanson douce. Par le choix du scope anamorphique et un savant jeu sur les couleurs et lumières, nous avons délibérément entraîné le film sur la voie du romanesque. La collaboration était particulièrement fluide entre nous, et j’ai adoré cadrer certaines prises avant de lui repasser la caméra : cela créait un dialogue entre nous parfois plus efficace que dans les mots ! Ces choix de direction artistique se sont aussi affirmés en travaillant en étroite collaboration avec les décors et les costumes.
d’hypnose.
Le scénario débute par l’adresse à la caméra d’Elody, qui est aussi un clin d’œil à la théâtralité. Le côté baroque du film me permettait de tout oser. L’idée que les femmes puissent avoir envie de mettre leur corps en représentation m’a toujours fascinée. Dans l’art en général, et le cinéma en particulier, le corps féminin a abondamment été utilisé comme élément d’envoûtement, comme produit d’appel, avec des variantes selon les époques. En tant que personnage, la strip-teaseuse est souvent présentée comme une victime, ou comme une ensorceleuse. Pour ma part, je souhaitais faire ressentir au spectateur ce que peut éprouver une jeune femme qui se lance dans le strip-tease. Car pour beaucoup - moi incluse -, cela reste un fantasme. Le film joue donc sans cesse entre conte et réalité, pour s’interroger sur notre rapport au désir, que l’on cherche à le susciter ou qu’il nous submerge.
Le film pose d’ailleurs plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Il ouvre et laisse ouverts de nombreux tiroirs…
C’est précisément ce qu’on cherchait à faire. Nous avions parfaitement conscience que nous abordions un sujet délicat. à mon seul désir est une ode à la liberté. Le personnage que nous suivons franchit les différentes limites auxquelles sont confrontées les travailleuses du sexe, sans être une victime – et sans pour autant dire que c’est la panacée, bien sûr. Au-delà de cette question, je crois à un monde où les femmes peuvent prendre tous les risques sans être punies pour cela. Je suis pour un féminisme pro-choix, polyphonique, complexe. Je n’ai pas de leçon à donner. L’art est là pour rendre compte de la complexité du réel et pour nous faire nous poser des questions, nous bousculer, et, le cas échéant, nous faire changer d’avis.
Mia exprime un avis tranché sur la prostitution à Aurore : elle estime que c’est le degré ultime de la soumission pour une femme.
La question des limites qu’on repousse m’intéressait. Quand on découvre Aurore, au début du film, elle pousse la porte d’un club de strip-tease pour la première fois et n’a aucune expérience. Dans chacun de mes films, j’explore la question du travail et la manière dont les gens s’y meuvent. Au club, certaines filles, dont Mia, ont établi des limites très claires. Le film offre à voir un autre point de vue avec celui d’Aurore, et c’est le questionnement que cela engendre qui m’importe.
Le personnage de Aurore plonge littéralement, à la manière d’une héroïne de conte, dans un monde souterrain, haut en couleur, et nous embarque avec elle.
Cette image du club installé dans une cave vient du réel. Symboliquement, c’est très fort. On descend au fond d’un endroit, dans un milieu interlope. Malgré l’industrie pornographique florissante sur Internet, il existe encore des lieux comme celui que montre le film. Cela m’intéressait d’être du côté du réel plutôt que du virtuel. J’avais à cœur que le film soit aussi un divertissement, qui donne à voir des spectacles de strip-tease drôles, inventifs. Il y a là l’idée d’une sexualité joyeuse ! à mon seul désir est aussi un film sur le théâtre, sur l’artifice de la scène.
Quel a été votre travail de recherches préparatoires ?
J’ai débuté l’écriture de ce scénario en 2014, dès que j’ai fini Fidelio, l’odyssée d’Alice. Depuis, il a toujours travaillé en toile de fond dans mon esprit. J’ai fait des recherches et des rencontres pendant longtemps, puis j’ai tout oublié pour pouvoir écrire des situations, des personnages. J’ai revu aussi beaucoup de peintures du XIXe siècle. Et des films, bien sûr.
Vous retrouvez Clara Bourreau à l’écriture du scénario. Comment avez-vous travaillé ensemble à la question des différents points de vue qu’adopte le film et à sa construction, qui fait penser à une poupée gigogne ?
Clara est ma complice de toujours. Nous avons l’habitude de travailler à partir d’anecdotes documentaires comme matière première. C’est un film que je souhaitais riche et généreux, avec beaucoup de portes d’entrée. Il aborde plusieurs sujets complexes, ce qui nécessitait une diversité de points de vue. S’est vite dessinée l’idée d’un duo, d’abord d’amies, puis d’amantes. Le côté poupée gigogne provient de l’ensemble des petites histoires que contient le récit. Après la découverte du club de strip-tease, Clara et moi avons décidé que l’histoire d’amour entre Aurore et Mia allait prendre le dessus et que nous allions en explorer chaque recoin. J’ai eu envie que ce soit une surprise pour le spectateur, car c’en est une pour les personnages elles-mêmes, qui ne voient pas arriver cet amour. Le fil rouge demeure la chronique de la vie d’une jeune femme sur quelques mois : elle découvre le strip-tease, s’y essaie par défi et curiosité, continue pour gagner de l’argent ; elle tombe amoureuse pour la première fois, puis se laisse tenter par la prostitution. Tout cela lui arrive en même temps, comme dans l’existence, où on vit souvent plusieurs choses à la fois de manière intense. C’est aussi parce qu’Aurore se sent puissante en osant ses expériences qu’elle peut accueillir cette histoire d’amour. Il m’importait beaucoup qu’il y ait un épilogue joyeux à cette histoire. Pour mieux prendre conscience de ce qu’elles ont vécu, le passage du temps est nécessaire pour les héroïnes, et donne du recul aussi bien au conte qu’à ses spectateurs.
La puissance de la sororité est un des piliers de ce film.
Dans Fidelio, je filmais un groupe d’hommes avec une femme au milieu ; ici, un groupe de femmes est au cœur de mon dispositif. Cette sororité n’est pas un fantasme : je l’ai observée sur le terrain. Il était important pour moi de la mettre en avant. Dans Nana de Zola, par exemple, les courtisanes sont en rivalité constante, et aussi bien dans la littérature que dans l’inconscient collectif, c’est ainsi qu’on imagine souvent ces femmes. Or, j’ai observé que dans ces endroits où l’on se met potentiellement en danger, une vraie solidarité opère. Il y a aussi beaucoup d’amusement, d’encouragements entre femmes, bien plus que de concurrence entre elles, qui sont d’âges, de milieux sociaux et d’origines variés. Un peu comme dans l’équipage de Fidelio, elles sont dans le même bateau et font bloc.
La question de l’argent est omniprésente. Vous le montrez concrètement.
C’était essentiel pour moi que ces filles décident de faire du strip-tease, et pour certaines de se prostituer, pour gagner de l’argent et non parce qu’elles y sont contraintes ou uniquement par plaisir. Tant que le capitalisme n’aura pas disparu, penser qu’on peut ne pas gagner d’argent reste une utopie. J’ai été fortement marquée par King Kong Théorie de Virginie Despentes, qui en parle très bien. Montrer concrètement l’argent - et sa valeur, de manière comique à travers le personnage d’Elody, qui est radine - était donc fondamental pour moi.
Comment avez-vous écrit les personnages masculins, dont beaucoup sont très bienveillants ?
Je recherche des nuances dans l’écriture de tous les personnages, hommes ou femmes. Ici, comme dans le réel, on trouve des hommes sensibles, vulnérables, amoureux, mais aussi des clients pénibles ou des harceleurs de rue.
Puisqu’on est du point de vue des strip-teaseuses, on a toute une galerie de clients dont le plus développé est le personnage d’Afflelou. Cet habitué notoirement radin, qui finit par succomber à Aurore, est à la fois touchant parce que timide, doux, maladroit et généreux, et en même temps il n’oublie jamais, jusque dans sa dernière scène, la volonté de faire Aurore sienne et de l’acheter. On voit aussi comment il mélange une relation tarifée avec un amour sincère. Pour ce personnage, il y a eu une rencontre assez magique entre l’acteur Sipan Mouradian et le rôle tel qu’écrit dans le scénario, comme si le film n’attendait que lui pour l’interpréter.
Du côté de Mia, l’homme qui partage sa vie, Benjamin, délicatement interprété par Thimotée Robart, représente une forme d’idéal masculin, qu’elle a du mal à quitter – à la fois beau et intelligent, voire même génial dans son domaine (il est chercheur en physique des particules). Il l’aime telle qu’elle est et tient à elle.
J’ai écrit le rôle de Pablo pour Pedro Casablanc, acteur espagnol que j’avais adoré filmer en terrible méchant de la série Cannabis. J’aime ce qu’il apporte, avec son visage marqué, comme surgi du monde de la nuit, son accent et les sous-entendus permanents qui émanent de lui.
Et bien sûr, je ne pouvais imaginer meilleur interprète que Melvil Poupaud, le capitaine de Fidelio, pour se prêter au jeu de l’acteur connu qui fait rêver Mia.
La thématique du regard est centrale dans ce film.
Le personnage d’Aurore observe beaucoup. Elle n’a pas de projets, ne se soumet pas aux diktats de la société. Elle est curieuse des plaisirs de la vie. Elle vit dans le présent et va aider Mia, qui, elle, est ambitieuse, à vivre davantage au présent comme elle. C’est sa force et c’est ce qui fait sa liberté. Mais Aurore est coincée au niveau de l’amour et Mia va l’entraîner à vivre une aventure sentimentale. Ce qui est beau, c’est cet échange entre elles, qui fait bouger leurs lignes à toutes les deux. Le regard d’Aurore sur le monde impose souvent une triangulation dans la façon de filmer qui infuse tout le film. Le regard est franc, mais le film est rarement frontal.
Dans le club, il y a le regard des filles sur scène et celui des clients dans la salle…
Absolument, c’est la question centrale, que nous n’avons cessé de nous poser à chaque étape de fabrication du film, et particulièrement dans les choix de découpage… On descend souvent dans la petite salle de spectacle, mais aucun show n’est filmé de la même manière ou du même point de vue. De la même façon, dans l’espace confiné de la loge, nous avions à cœur de renouveler sans cesse la manière de filmer, pas seulement pour varier les plaisirs, mais aussi parce que notre regard évolue sur les silhouettes qui deviennent peu à peu des personnages aux préoccupations de plus en plus précises. On ne voit pas seulement les corps, on filme des gens.
Corollaire de la question du regard, le motif du miroir traverse le film.
Cela vient du réel, il y a des miroirs partout : dans les loges, sur la scène... Du point de vue symbolique, c’était important pour moi qu’il y en ait dans l’hôtel où Aurore se prostitue, car cela induisait l’idée du consentement avec elle-même : elle se voit et a conscience de ce qu’elle fait. C’est aussi lié à la thématique de l’image de soi. De nombreuses strip-teaseuses sont très timides hors de la scène, et trouvent dans ce lieu la confiance de se regarder dans une glace, d’aimer leur corps. Et cela permet d’incarner à l’image l’idée du double, qui commence pour les strip-teaseuses avec le choix de leur pseudonyme.
Quelque chose de sensoriel et sensuel se dégage de votre mise en scène.
Je cherchais à restituer la puissance du corps des femmes, la puissance de la sensation, de l’intime. Le film est rythmé, et je voulais qu’il recèle des surprises. Cela a guidé notre travail avec Clémence Diard, la monteuse. Les aspects les plus explicites sur le plan sexuel se trouvent volontairement au début. Je tenais à ce que le film n’expose pas la vie d’Aurore, mais la plonge d’emblée dans ce club. Son histoire d’amour avec Mia se déroule aussi dans le désordre : elles commencent par faire semblant de coucher ensemble sur scène pour le faire vraiment par la suite, puis par tomber amoureuses. Elles font tout à l’envers ! La sensation est ce qui m’intéresse le plus au cinéma. C’est déjà quelque chose que je cherchais à susciter dans Fidelio, avec l’idée de la traversée, et Chanson douce sur un versant plus sombre, comme un cauchemar de parents.
La gaieté est omniprésente dans votre image !
Je tenais à cette joie, car le strip-tease est un univers qui a souvent été montré au cinéma de façon glauque. Il ne s’agissait pas d’être naïve pour autant : je montre bien que des moments trash ont lieu parfois dans les salons privés, comme au début du film, ou à l’extérieur, comme dans la scène de l’enterrement de vie de garçon. Je tenais à poser cet aspect dans la première partie, mais je voulais que l’amusement domine. Car c’est ce que j’ai observé dans le club qui m’a inspiré ce décor. J’ai rencontré des femmes qui expérimentaient toutes sortes de choses sur scène avec de la joie. Beaucoup aiment faire les pitres, osent, repoussent les limites de la bienséance et cela fait rire les spectateurs. Par ailleurs, nous avons tourné après les confinements successifs dans l’idée que rien ne remplace le lien à l’autre. Dans ces clubs, il y a aussi une clientèle d’habitués, de gens seuls qui viennent chercher du réconfort.
Dans la séquence où Mia raconte l’abus dont elle a été la victime, vous dépouillez votre image de tout artifice et mettez la parole au centre.
Je tenais à ce fond noir et à ce découpage classique pour cette scène. Je suis tellement admirative de cette idée, au cœur du mouvement MeToo, de la parole exprimée et entendue. C’est un vrai changement de paradigme, même si les problèmes perdurent. Je n’aurais sans doute pas filmé cette séquence comme ça en 2014, quand j’ai commencé à écrire mon scénario. MeToo a changé la donne. Et la parole, dans cette séquence, devient littéralement le cœur de la scène avec ce plan déréalisé.
Comment vous est venue l’idée des visions d’Aurore, qui déshabille les passants du regard à la manière d’une magicienne ?
C’est venu tôt au scénario, comme une manière de faire entrevoir ce que représente la sensation de mise à nu lorsqu’elle perdure en dehors du club. Dès le premier soir, Aurore a l’impression de voir tout le monde nu en sortant de scène. C’est quelque chose qui m’a été raconté par les strip-teaseuses que j’ai rencontrées. Et puis je voulais sortir la nudité du club, et de toute sexualisation, montrer des corps d’hommes et de femmes de tous âges, qui ne soient pas que ceux des danseuses. Dans la nudité, nous sommes tous égaux. Cela apportait aussi de la poésie au film, car cela ressemble à un tour de prestidigitation. C’est une petite folie, un trucage à la Méliès ! Et une manière de rendre hommage à la magie du cinéma.
Comment avez-vous composé votre casting féminin ?
J’ai pensé à Zita Hanrot très tôt, et j’ai même écrit le rôle de Mia pour elle. Je lui trouve une beauté fatale d’actrice hollywoodienne et un grand charisme, qui apportaient beaucoup au personnage de cette femme qui rêve de devenir comédienne. Sa sensualité m’évoque celle de Scarlett Johansson, elle a cette même puissance immédiate. Mia se ment à elle-même, elle est prise dans des conflits intérieurs, elle est ambitieuse, aime séduire, fait le clown sur scène tout en préparant le Conservatoire, pour lequel elle travaille Racine et Tchekhov : il y avait tellement de niveaux de jeu pour Mia qu’il me fallait une excellente actrice prête à aller loin dans le travail et la précision. Zita est capable de cela.
Pour Aurore, j’ai fait un casting avec quelques actrices, parmi lesquelles Louise Chevillotte, que j’avais découverte dans les films de Philippe Garrel et Nadav Lapid. C’est une formidable actrice dotée d’une grande finesse de jeu. Elle a lu le scénario très vite et a réagi spontanément et positivement.
J’avais bien conscience que ce film pouvait faire peur, et j’ai senti que Louise et Zita avaient l’audace et le courage d’y plonger ensemble. Elles formaient le meilleur couple possible à mes yeux, un duo d’une véritable évidence. C’est une affaire de corps, de voix, d’énergies complémentaires. Elles étaient sur un pied d’égalité tout en ayant l’air de ne s’être jamais rencontrées et de tout devoir au côté fortuit du club. Pour moi ça rend ce couple moderne et intéressant. Leur relation ne se joue pas sur la question du pouvoir.
Pour Elody, j’ai confié le rôle à Laure Giappiconi, qui a collaboré au scénario et joue dans chacun de mes films.
Pour le reste du casting, j’ai travaillé avec Colia Vranici. Elle a rencontré toutes sortes de personnes, y compris de vraies strip-teaseuses, dont certaines apparaissent dans le film. S’est, pas à pas, formée une troupe avec des actrices de tous horizons.
Comment avez-vous travaillé avec votre groupe d’actrices ?
Nous avons monté une résidence de strip toutes ensemble, sans caméra, sans appareil photo. Colia et moi nous y sommes essayées aussi. Cela nous a toutes nourries et permis d’explorer nos possibilités et de poser les limites de chacune. Je suis extrêmement heureuse d’avoir pu ensuite mobiliser les comédiennes pour qu’elles écrivent elles-mêmes leurs numéros, comme le font les strip-teaseuses du club qui nous a inspirées.
Comment avez-vous choisi les plus petits rôles ?
Nous avons été très attentives à choisir des acteurs et actrices les plus respectueux et respectueuses qui soient ! La formation sur les violences sexuelles et sexistes du CNC que ma productrice a suivie s’est révélée une excellente boîte à outils pour notre tournage. Nous avions rédigé une lettre à l’attention de toute l’équipe, y compris les comédiens et comédiennes, sur cette question avant le début du tournage, et Colia est devenue notre référente harcèlement sur le plateau. Pour que tout le monde soit en confiance, elle avait, lors du casting figuration, rencontré avec son assistante Naomi Grand chaque figurant individuellement pour les scènes de club pour éviter tout potentiel problème – ce qu’on ne fait à ma connaissance jamais pour les figurants.
Comment avez-vous composé cet univers baroque à l’image, aux décors et costumes, avec vos collaborateurs ?
À l’image, j'ai eu la joie de retrouver Alexis Kavyrchine, après Chanson douce. Par le choix du scope anamorphique et un savant jeu sur les couleurs et lumières, nous avons délibérément entraîné le film sur la voie du romanesque. La collaboration était particulièrement fluide entre nous, et j’ai adoré cadrer certaines prises avant de lui repasser la caméra : cela créait un dialogue entre nous parfois plus efficace que dans les mots ! Ces choix de direction artistique se sont aussi affirmés en travaillant en étroite collaboration avec les décors et les costumes.
J’ai fait la connaissance d’Alexia Crisp-Jones, qui était cheffe-costumière sur Tournée de Mathieu Amalric, notamment. Alexia a créé des costumes qui mêlent le bijou à la lingerie et qui magnifient le corps des femmes. Ses tenues sont à la fois crédibles et oniriques, et subliment des accessoires parfois relégués au champ de la vulgarité. Elle a travaillé main dans la main avec le chef décorateur Aurélien Maillé, qui est parvenu à mélanger le kitsch et le charme avec brio. Notre premier rendez-vous de travail avait eu lieu dans une exposition sur la peinture érotique du XVIIIe siècle à la réouverture des musées après le deuxième confinement, et nous avons toujours essayé de garder de l’ambition dans la frivolité, jusque dans les moindres détails.
La dimension romanesque a continué de guider notre travail au montage : nous avons privilégié l’emballement, le rythme, les ruptures.
Comment avez-vous travaillé à la bande-son du film ?
Avant le tournage, j’ai cherché, avec le superviseur musical Frédéric Junqua, des musiques préexistantes d’horizons divers, car beaucoup de numéros étaient musicaux. J’ai toujours aimé mélanger différents styles. Nous avons commencé à travailler les numéros sur ces titres dès la résidence de strip.
J’ai aussi travaillé avec le compositeur Pierre Desprats, qui a réussi à imaginer des partitions très créatives pour accompagner les visions d’Aurore, l’histoire d’amour et les sensations des personnages, comme il l’avait fait pour Chanson douce.
Surtout, j’ai eu la joie immense de collaborer avec la chanteuse Rebeka Warrior (Sexy sushi, Mansfield Tya, Kompromat…), qui a composé pour le film deux chansons : l’une dans le plus pur style de Sexy sushi pour un numéro du samedi soir, et l’autre qu’on entend à la fin et qui scande le titre comme un refrain, ballade romantique digne d’une comédie musicale.
Votre titre, à mon seul désir, fait écho à celui de la sixième toile, auréolée de mystère, de la tapisserie moyenâgeuse La Dame à la licorne. L’aviez-vous en tête en écrivant cette histoire ?
Cette tapisserie est une de ces œuvres qu’on croise dans sa jeunesse et qui vous poursuivent. C’est un choix de ma part de vouloir rattacher le club, nommé "à mon seul désir", à l’histoire de l’art et celle de la représentation du corps des femmes. Cette tapisserie repose sur les cinq sens et un mystérieux PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-CLAIRE CIEUTAT sixième sens : est-ce le désir, l’intuition féminine ? Elle met en scène, comme dans mon histoire, un couple, un duo de femmes, dont on sent la puissance. La licorne de la tapisserie figure sur un mur dans la rue, à l’entrée du club. C’est une petite touche, une clé discrète. La licorne aujourd’hui est aussi un symbole de liberté, d’utopie, un symbole queer qui va bien avec le film.
Comment êtes-vous ressortie de cette expérience ?
Je suis dans la joie d’avoir pu faire un film non formaté. J’espère qu’il saura divertir, emporter et faire bouger les lignes dans l’esprit de ses spectateurs. Je vais très souvent au cinéma, parce que ça me sauve la vie. J’attends d’un film, y compris des miens, qu’il soit complexe, inattendu et bouleversant… comme peut l’être un numéro de strip-tease !
(Dossier de presse)