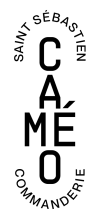Houria
Entretien avec Mounia Meddour, réalisatrice
Comment est née l’histoire de HOURIA ?
Au départ, il y a eu l’envie de continuer à explorer la société algérienne actuelle avec ses problématiques actuelles et ses richesses humaines et linguistiques. Avec HOURIA, je me replonge dans l’histoire algérienne actuelle pour raconter l’histoire d’une jeune danseuse qui va se métamorphoser à la suite d’un accident. Venant du documentaire, j’aime puiser au fond de moi des souvenirs et des expériences pour les retranscrire en fiction au cinéma. À la suite d’un accident, double fracture de la cheville, j’ai vécu une longue rééducation qui m’a immobilisée pendant quelque temps. J’avais envie de raconter l’isolement, la solitude et le handicap. Mais surtout la reconstruction. Houria va finalement devenir encore plus forte après cette renaissance. Elle va devenir ellemême. C’est ainsi que j’ai imaginé le personnage de Houria, une héroïne grandiose par son endurance, à l’image de cette Algérie, blessée mais toujours debout.
Au début du film, on ressent la différence entre la danse, qui se passe le jour, dans la lumière, et l’univers des combats de béliers et des paris clandestins qui se passent la nuit. Vouliezvous aussi marquer la différence entre le féminin et une certaine conception viriliste du masculin ?
En effet, il y a un parallèle entre l’univers de la danse, féminin, aérien et solaire et l’univers masculin nocturne et viril. Il y eu aussi cette volonté purement cinématographique de filmer ces combats de béliers, typiquement algériens. On connaît les batailles de buffles au Vietnam, les combats de coqs venus d’Angleterre au 18ème siècle, moi j’avais envie de montrer cette spécificité algérienne, activité qui s’est répandue après l’indépendance. Ces combats préparaient aussi le terrain de la danse contemporaine qui occupe la deuxième partie du film : une danse très ancrée dans le sol, la terre,…Les combats de bélier montrent les prémices de cet univers-là.
Houria et sa mère, Sabrina, sont danseuses, vivent sans hommes, ne portent pas le voile, Sabrina fume… Pour vous, le féminin, l’appétence artistique et l’aspiration à la liberté ne font qu’un ?
Oui pour moi la liberté individuelle aspire à une envie de s’épanouir, à s’exprimer et à explorer des chemins artistiques variés. En Algérie le poids des traditions et le patriarcat est trop présents et il est très difficile de s’émanciper quand on est une femme. Dans le film, Sabrina est une femme cultivée, qui a du talent et qui gagne sa vie dignement même si pour certains danser dans des mariages est quelques chose de scandaleux.
La liberté individuelle et l’expression corporelle sont limitées pour l’ensemble des Algériens, mais encore plus pour les Algériennes semble dire votre film ?
Complètement. Pour reprendre l’exemple de la danse, elle se pratique en lieux privés, mais très peu en extérieurs. Le corps des femmes est tabou. Une femme qui danse, c’est une femme qui désire s’exprimer. C’est pas anodin dans une société patriarcale et traditionnelle, avec des mœurs et des mécanismes d’honneur. Il faut un changement des mentalités mais le chemin est encore long.
Houria est brisée dans son élan par une agression commise par un homme dont on apprend plus tard qu’il est un ex-terroriste islamiste. La guerre civile est terminée mais elle marque encore la société algérienne ?
Malheureusement, vingt ans après la fin de la guerre civile, les familles des victimes exigent toujours la justice et la vérité. L’amnistie d’une partie des détenus est une sorte d’injustice vis-à-vis de ces familles. J’ai des amis victimes du terrorisme qui ont lutté au sein d’associations contre cette loi d’amnistie mais malheureusement cette loi a été adoptée et ces repentis sont en toute liberté dans la société. Mais le repenti du film métaphorise un mal plus général, celui de la guerre civile, comme une sorte de fantôme du passé, qui rôde toujours.
Dans les scènes au commissariat, vous montrez la passivité des institutions, la façon dont le pouvoir a acheté la paix sociale en amnistiant les ex-islamistes.
Aujourd’hui, la population est absorbée par les problèmes du quotidien. Avoir un travail, un logement, un statut social, toutes ces difficultés gangrènent malheureusement le quotidien et nous poussent à fermer les yeux sur ce qui s’est passé dans le passé sans le régler. L’amnistie des repentis terroristes est d’une grande violence pour les familles des victimes.
Houria devient muette et se reconstruit au sein d’un groupe de femmes handicapées, la plupart muettes aussi. Le mutisme estil la métaphore de l’impossibilité de parler librement ?
Absolument. Le mutisme d’Houria est clairement symbolique de toutes ces femmes qu’on a voulu faire taire, qu’on a chassées, écartées, étouffées, humiliées et réduites au silence. Houria symbolise toutes les sans-voix.
La contrepartie du mutisme, c’est l’expression corporelle, le langage des signes et la danse, que vous mêlez.
Oui, la communication passe par les corps, ces corps qu’on a voulu empêcher. Ces corps blessés vont se « réparer » par la danse signée pour trouver une sorte de liberté et de beauté. Dans le film on danse car on a besoin de communiquer avec son corps, avec les autres et créer du lien. Les femmes ont aussi un désir de création et un besoin de transformation.
On a le sentiment aussi que ce langage de la danse et des signes est une langue clandestine, une langue de résistance que le pouvoir ne peut pas comprendre.
Tout à fait. Dans la première partie, Houria est corsetée dans la danse rigide qu’est la danse classique, puis après son agression, elle libère son corps en se livrant à un nouveau langage corporel. Au contact de ces femmes abîmées par les accidents de la vie, qui ont renoncé à la parole au profit de la langue des signes, Houria va s’épanouir. Elle va murir un projet de chorégraphie signée comprise uniquement par ces femmes. Un lien fort et une langue presque secrète et clandestine va les unir pour dire les maux de la société actuelle.
Le langage corporel est aussi très cinématographique, ce que votre mise en scène souligne en privilégiant les corps, les gestes, les mouvements.
Tout à fait. Filmer la danse est une chose très complexe. Mon parti pris a été de filmer les danseuses dans leur liberté. J’aime filmer mes personnages au plus près des corps, de la peau, du mouvement. Dans la mise en scène de ce film, on s’est beaucoup interrogé avec le chef opérateur sur comment filmer la danse, quels choix opérer, quelles scènes de danse privilégier. Quand on filme la danse il faut accepter de perdre quelque chose. Pour moi il fallait absolument éviter la captation et privilégier les corps, les mouvements, une expression, un regard. Souvent dans les films de danse, la chorégraphie est pensée pour la caméra ou rechorégraphiée pour une mise en scène cinématographique. La chorégraphie est donc la matière première, et non le scénario. Pour nous ça a été l’inverse. La caméra venait chercher des choses sur le vif, tel un documentaire, dans une chorégraphie très précise laissant ainsi une totale liberté aux comédiennes et aux danseuses.
Comme dans PAPICHA, Houria et ses amies s’émancipent à travers un projet créatif et collectif. Cela renvoie aussi à votre propre activité de cinéaste. L’art collectif est-il un des meilleurs moyens de lutter contre l’oppression ?
L’art de façon générale peut nous aider à survivre et à obtenir une certaine liberté et plus particulièrement dans des sociétés patriarcales. L’art collectif peut être source d’émancipation et avoir un impact fort. On peut résister avec des images, on peut combattre avec des mots ou avec de la poésie engagée. Dans HOURIA, les femmes se regroupent autour d’un projet artistique collectif et fédérateur, la danse. Ensemble, elles améliorent leur condition de vie et sont plus fortes et plus résistantes. Résister par l’art c’est aussi désobéir, s’insurger, tenir tête, ne pas participer à ce qui est imposé. C’est exactement ce qui arrive aux femmes dans Houria lorsqu’on ferme la salle de danse. Elles refusent d’annuler le spectacle et d’arrêter de danser. Elles ne veulent pas mettre fin à leur projet artistique commun qui a donné un sens à leur vie et conservé leur dignité. Ce spectacle de danse leur permet d’avoir un peu de dignité et de s’évader de la réalité algérienne.
Il y a aussi le personnage de Sonia, la meilleure amie d’Houria, qui veut fuir vers l’Espagne et qui aura un destin tragique. Ce personnage pose une question complexe : quand on est opprimé, vaut-il mieux quitter son pays ou rester et lutter de l’intérieur ?
Sonia choisit l’exil meurtrier en rejoignant l’Europe à partir d’embarcation de fortune. Elle étouffe dans son pays qui ne la rend pas heureuse. Elle a essayé d’obtenir son visa de façon officielle mais ses nombreuses demandes ont été refusées. Alors, comme beaucoup de migrants clandestins algériens, elle tente ce voyage au péril de sa vie. Cette année plus de 400 jeunes algériens ont perdu la vie dans des tentatives désespérées de traverser la Méditerranée. Il y a de plus en plus de femmes et d’enfants qui quittent le pays pour des raisons économiques, sociales ou familiales. Taux élevé du chômage, cherté de la vie, manque de stabilité politique et de liberté sont des facteurs qui mènent au désespoir et à la frustration. Bien évidemment ce n’est pas la solution. Il faut dissuader les volontaires en leur offrant plus d’opportunités de réussite et punir d’avantage les trafiquants, même si la législation algérienne a déjà inclut une punition sévère dans le code pénal en 2009 relatives au trafic de migrants mais cela n’a pas réglé le phénomène, bien au contraire. Ce business est très lucratif pour les réseaux mafieux et autres passeurs qui gèrent ces passages clandestins. Cette situation est très inquiétante car elle révèle le mal-être d’une jeunesse algérienne qui ne croit plus au discours officiel et pour laquelle la confiance avec les gouvernants semble définitivement rompue.
Comment s’est passée votre collaboration avec Léo Lefèvre, votre chef opérateur ?
On avait déjà travaillé ensemble sur PAPICHA, c’est d’ailleurs quasiment la même équipe sur Houria. C’est une équipe fidèle, qui connaît bien ma façon de travailler, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Avec Léo, on a fait pas mal de recherches visuelles, moodboard et des lectures pour comprendre l’évolution du personnage et réfléchir à comment filmer la danse. Je trouve que c’est un exercice difficile car pour moi un spectacle de danse se vit et se ressent, le mouvement est difficile à capter, le filmer c’est l’amputer forcément de quelque chose. Alors nous avions décidé de prendre le parti pris de se concentrer sur les expressions et les émotions de notre héroïne. Ainsi nous pouvions être au plus près de notre personnage et ressentir ce qu’il ressent et vit. Mais au-delà de la danse, ce qui nous intéressait le plus c’était de capter le rêve brisé de cette danseuse et sa longue reconstruction. Martha Graham disait « qu’un danseur meurt deux fois. D’abord quand il arrête de danser, cette première mort est la plus douloureuse ». C’est cette renaissance à travers sa nouvelle créativité que nous voulions incarner avec une caméra plus posée, plus lente en phase avec le processus de rééducation. Ce qui nous importait aussi c’était de filmer au mieux ce groupe de femmes qui se forme à partir de la danse. Avec Léo, on découpe très peu justement pour que les comédiens trouvent leur place dans l’espace et se sentent le plus libres possible.
Comment avez-vous collaboré avec Hajiba Fahmy, la chorégraphe ?
Dès le début de la préparation il y a eu beaucoup d’échanges et d’allers-retours entre Hajiba Fahmy, la chorégraphe, notre conseiller en langue des signes, Antoine Valette et les compositeurs Yasmine Meddour et Maxence Dussere. Comme pour la musique, on a démarré par la chorégraphie finale. C’était celle qui était la plus complexe à créer, elle devait être puissante et libératrice à la fois. Houria devait puiser son énergie dans le sol et la diffuser dans tout son corps. Une danse naturelle avec un rythme qui envahit le corps. Pour cette chorégraphie on a d’abord traduit en langue des signes des passages du scénario puis Hajiba a réinterpréter chaque signe en mouvement pour créer cette chorégraphie signée finale symbolique de la force et de la libération de Houria. Ce processus a été long et laborieux mais très stimulant et créatif. Hajiba a aussi préparé Lyna (Khoudri) physiquement pour la danse classique et le Lac des Cygnes, un travail extrêmement rigoureux et exigeant. Globalement, il y a donc eu un travail circulant entre toutes ces composantes : la langue des signes, la chorégraphie, la mise en scène, le filmage, le jeu de Lyna et des autres comédiennes. Lyna devait exprimer tout sans parole, par les mouvements et les regards. On a travaillé avec des moodboard avec Hajiba afin de capter les mouvements mais aussi les regards.
Comment s’est réparti le travail musical entre Yasmine Meddour et Maxence Dussere ?
L’idée de ce duo est née d’une volonté de conjuguer deux univers. Celui de la pianiste compositrice Yasmine et celui du compositeur Maxence, passionné de musique électronique. La musique de la chorégraphie de fin a été composée en premier car nous en avions besoin pour les répétitions et le tournage. Je voulais que cette musique soit organique, charnelle, presque tribale avec des percussions vives et envoûtantes. Après plusieurs allers-retours, on a trouvé l’alchimie parfaite et de cette composition finale a découlé le reste de l’esthétique musicale du film. Les compositions racontent le tourment et la reconstruction de Houria. Au départ c’est une musique fragile composée de fragments rythmiques mélodiques qui évolue vers une musique puissante et la voix chantée vient s’imposer comme un cri de liberté. Le parti pris était de faire intervenir la musique seulement après l’agression et la perte de la voix. L’intention était de donner une voix à Houria alors que celle-ci la perd à la suite de l’agression. Cette musique devient la sienne, au même titre que son corps lui réappartient petit à petit.
Pouvez-vous évoquer le travail des comédiennes, à commencer par Lyna Khoudri ?
Avec Lyna on a la chance de se connaître très bien et l’essentiel de notre travail sur Houria était consacré à la construction d’un personnage d’une profonde justesse. Dans le film, on signe, on parle de mutisme, de choc post-traumatique, de rééducation physique, il était indispensable de collecter un maximum d’informations pour construire un personnage juste, précis et crédible. Pour moi qui vient du documentaire, il était indispensable d’avoir toute cette matière pour commencer à composer le rôle de Houria. On a donc commencé par de nombreux entretiens avec des psychologues et des neurologues pour essayer de saisir ce qui se passe dans la tête de Houria et comprendre son mutisme à la suite du choc post-traumatique. D’ailleurs un livre : « Le langage blessé », a accompagné Lyna tout au long de cette préparation. Il y a eu ensuite un apprentissage de la langue des signes avec Antoine Valette, notre conseiller en langue des signes, qui avait traduit des passages du scénario. Ce travail a été précieux car il nous a servi de matrice pour chorégraphier les danses avec notre chorégraphe Hajiba Fahmy. Et puis bien sûr, on a lu de nombreux ouvrages et biographies sur Pina Baush, Marie-Claude Pietragalla et Martha Graham, visionné des ballets classiques, des spectacles contemporains mais aussi des clips très créatifs comme ceux de Sia avec ses chorégraphies bluffantes aux mimiques faciales incroyables.
Et puis au-delà du travail sur la danse, le handicap, le corps, il a fallu travailler le jeu, l’intériorité du personnage, décortiquer les enjeux de chaque scène pour incarner cette jeune femme qui vit dans un Alger étouffant.
Les autres comédiennes sont également magnifiques…
Toutes les comédiennes du film sont très talentueuses ! Sonia est jouée par Amira Hilda Douaouda, qui est à mes yeux une comédienne extraordinaire, très juste et d’un naturel bluffant ! Elle est également chanteuse dans la vie. Elle connaît très bien le sort de ces milliers de femmes qui partent sur des embarcations précaires. Elle imprime à Sonia une qualité à la fois joyeuse et émouvante. Joyeuse parce qu’elle a cette pulsion de vie, cette soif de liberté et de courage de dire non à cette Algérie qui l’a emprisonnée. Emouvante parce qu’elle a une part de naïveté en croyant qu’elle va traverser facilement la Méditerranée. Nadia Kaci, qui joue Halima est une merveilleuse comédienne, magnifique de justesse. Je sais que jouer le rôle de Halima l’a vraiment touchée et marquée. À la lecture du scénario, elle m’a appelé pour me dire à quel point le rôle de Halima l’avait touchée et à quelle point elle a été sensible à ses « blessures ». Nadia Kaci a d’ailleurs reçu en 2010, le Prix littéraire des Droits de l’Homme décerné pour le récit « Laissées Pour Mortes ».
PAPICHA a connu un beau succès en France. Vos films sont-ils vus en Algérie ? Plus généralement, le cinéma peut-il contribuer aux combats pour l’émancipation ?
PAPICHA n’est pas sorti en salles en Algérie alors que le film possède un visa d’exploitation et a été soutenue par le Fdatic, une institution qui dépend du ministère de la Culture. Le film a été privé de sortie mais il a quand même représenté l’Algérie aux Oscars en 2020 et a été vu, de façon officieuse, par la majorité des algériens. C’est le paradoxe de l’Algérie ! Il y a d’une part ceux qui aiment le film pour son authenticité et parce qu’il les renvoie à eux même et à la société dans laquelle ils ont vécu, et il y a ceux qui le détestent pour les mêmes raisons. Je pense que les premiers ont certainement pris du recul sur ces événements tragiques et les seconds refusent de voir cette réalité, encore trop dure, en face. Une image peut être très dure, très impactante. C’est dans ce sens que je trouve que le cinéma est primordial et nécessaire. Il peut être un outil thérapeutique merveilleux ! Il nous libère de nos fantômes du passé qui peuvent encore hanter notre présent. Il nous permet aussi une ouverture sur le monde qui nous entoure d’où l’importance de la diversité cinématographique. Les cinémas du monde nous aident à mieux comprendre et cerner les problématiques de chaque pays. La presse et les médias font déjà ce travail, mais le cinéma et les images ont un impact émotionnel et sensible plus fort. Et bien évidemment, le cinéma contribue aux combats pour l’émancipation des femmes. Quand on a à l’écran un personnage principal féminin inspirant qui s’impose et qui incarne une femme forte, cela permet aux femmes de mieux s’identifier. Aujourd’hui, on déculpabilise de plus en plus les femmes qui rêvent d’émancipation à l’écran.
(Dossier de presse)