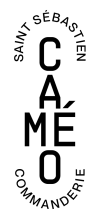Un petit frère
Entretien avec Léonor Serraille, réalisatrice
Comment est née l’idée de Un Petit frère ?
Je crois que le film est né d’un manque, et d’un étonnement de ne pas voir cette histoire-là portée au cinéma, alors qu’elle faisait autant partie de mon pays, de ma vie. Ce projet de « roman de famille » est également lié à un besoin que j’avais de raconter une partie de leur histoire à mes enfants, ou du moins une interprétation de cette histoire.
Après Jeune femme j’avais aussi envie de me tourner vers un projet très différent et romanesque. J’en ai parlé au père de mes enfants car le projet prenait soudain forme dans ma tête. Je cherchais j’imagine une forme de « validation » de sa part mais il m’a répondu « ce qui compte c’est que tu racontes cette histoire à ta façon ».
J’ai mis quelques mois à intégrer que ce serait très librement inspiré de son histoire et que ce serait mon film. J’y ai vu un territoire qui correspondait aux questionnements qui m’habitaient à ce moment-là : qu’est-ce que ça veut dire être une famille? Être une mère, un fils ? Venir d’ailleurs, et être français ? Le film vient de cette carte blanche totale qui m’a été donnée. J’ai abordé le film avec un mélange de libertés et de responsabilités.
Vous avez en partie répondu à une des interrogations du film, mais je vous pose néanmoins la question : comment fait-on pour filmer et ressentir et filmer de l’intérieur le parcours d’une famille franco-africaine quand on n’est pas soi même d’origine franco-africaine ?
Je pense que j’étais imprégnée de cette histoire d’une façon ou d’une autre.
Je me serais sentie plus perdue si je m’étais intéressée à une famille de paysans français du 18ème siècle. Cette histoire me touchait profondément, j’y voyais une richesse de sujets la traversant.
J’ai cherché à comprendre les personnages, à les laisser me gagner émotionnellement. Le cœur de l’écriture a été de les esquisser comme des individus singuliers et complexes, et c’est comme cela que j’aime être approchée, moi-même, dans la vie, comme une personne avec une pluralité d’aspects. Par exemple je suis une femme mais je ne veux pas être ramenée à cela en permanence, car cela n’explique pas tout de mon identité.
Pour cette famille, c’est un peu la même chose. Ils sont nés ailleurs, et arrivent en France, bien sûr, cela les constitue. Mais la société, les médias, et ces derniers mois plus particulièrement les politiques se chargent bien assez de poser des étiquettes, des mots, des définitions sur les gens. Au cinéma on peut partir chercher autre chose justement. C’est une exploration. On va voir ce qu’il y a derrière ce qu’on projette sur nous. En tout cas c’est ce que j’ai tenté de faire. D’amener des éléments pour changer mon propre regard.
J’ai essayé de les observer à hauteur de héros, des héros de roman, parce que je les voyais tels quels. Il fallait se faire discret, leur faire de la place, et montrer leur complexité, leur délicatesse aussi. Les acteurs sont tous de très grande taille, j’avais peut-être un souhait inconscient qu’ils impriment en « grand » les cadres, qu’ils s’affirment comme des figures, des modèles, des repères.
Comment s’est passée l’écriture ?
Assez vite, je me suis centrée sur un trio, dans un portrait qui serait « mouvant » dans le temps : une mère et ses deux fils. Je leur ai donné à chacun une partie, de façon assez équitable. Cette structure simple en trois blocs m’a toujours intéressée, elle est dialectique et permet les résonances, les progressions, les ruptures franches. Je sortais du montage de mon premier long métrage, et mon écriture en était transformée.
C’était le moment d’expérimenter des choses nouvelles. J’ai suivi des éléments très concrets et des points de repères proches du vécu : une arrivée en France à la fin des années 80, des points de chute précis, des étapes clés. J’étais libre d’inventer, ajouter, soustraire.
La structure du film est assez originale. À la fois linéaire et en étoile.
Elle s’est imposée d’elle-même. Les trois personnages m’intéressaient tous.
J’aimais bien que les époques coulissent entre elles par leur intermédiaire. À l’intérieur des parties, j’ai déployé des fils narratifs, comme des parenthèses dans la structure, des respirations autorisées pour chaque personnage. Chacun a ses moments hors de la dramaturgie, qui ne « servent à rien » et qui pourtant sont essentiels, comme des échappées, des fenêtres qui s’ouvrent, et qui laissent le film respirer. C’était le cœur du montage, de trouver cet équilibre ténu en taillant au plus vif le récit, tout en assumant des touches plus impressionnistes.
Vous montrez une famille monoparentale où le père est absent. Rose appartient aussi à la catégorie des travailleuses de première ligne. Etait-ce important politiquement, socialement, de montrer cela ?
Oui et non. « Oui » parce qu’à partir du moment où on veut filmer la vie, on se positionne forcément, c’est toujours politique de montrer une femme seule menant sa vie, sur tous les fronts.
Et « non » car le politique, s’il doit être présent l’est j’espère de la façon la plus invisible qui soit, comme « infusé ». Je n’ai ni discours militant ni message dans le film. Comme spectatrice, j’y suis souvent réfractaire, ça me fait fuir.
Ceci dit, j’ai toujours manqué d’engagement politique dans ma vie. J’essaie peut-être de me rattraper, d’une façon différente. Quand j’ai évoqué ce projet de film à ma belle-mère, elle était surprise, presque déçue : « mais on n’intéresse personne, ça n’intéressera personne. ». Comment ne pas ressentir de la tristesse, de la colère ? Ça a décuplé mon envie d’écrire.
Ce sont aussi des héros de l’intégration invisible et silencieuse dont parle si bien Stéphane Beaud dans La France des Belhoumi. Celle qui n’intéresse pas les médias qui se focalisent sur les modèles de réussite comme Rachida Dati ou sur les dealers quand ce ne sont pas les Djihadistes. Il faut réparer ça, c’est certain. Quand je vois la vie de Rose, je me dis « quel courage » ! Et moi aurais-je autant d’audace et de modernité qu’elle ?
La plupart des gens ne se plaignent que très peu, ils travaillent ou espèrent travailler, ils s’aiment, ont des enfants ou pas, vivent du mieux qu’ils peuvent. Ils jouent le jeu, ils paient leurs impôts, mènent leur vie. Il y a un manque de ces histoires au cinéma.
Au casting j’ai été frappée par le nombre d’acteurs ou d’actrices qui m’ont dit « ah ! mais oui c’est la vie de ma sœur, de mon frère, de ma tante… »
J’aime quand le cinéma raconte la vie ordinaire des gens que je trouve extraordinaires. Ça console un peu. Ces histoires-là sont très intériorisées.
Autre trait marquant, elle ne s’auto-victimise jamais.
Oui, elle avance. Elle fait, elle ose, elle verbalise peu. Elle attend beaucoup de ses enfants, parce qu’elle-même se met la barre relativement haute. Il y a une certaine forme de dureté en elle, mais c’est aussi un moteur pour traverser des épreuves.
Parlons des fils, et de l’aîné, Jean. Très doué à l’école, puis rattrapé par une forme de dépression à 20 ans. Comment avez-vous conçu son évolution ?
Jean est un enfant qui arrive en France avec beaucoup d’espoir posé sur lui. Comme tout enfant qui aime sa maman il veut combler les attentes qu’elle place en lui.
Plus tard, il est une nouvelle fois transporté dans un autre élément, la bourgeoisie rouennaise, dans laquelle il ne se sent pas légitime, il y a la culture qui lui manque peut-être, ou certains codes. La réussite scolaire toute seule ne peut pas tout. Ça m’intéressait de dessiner ce « devoir de réussite », d’interroger ses limites. C’est un grand frère qui fait aussi office de « père » pour son petit frère, et il est écrasé de responsabilités.
A-t-il eu le temps de rêver sa vie ? C’est cet état que je voulais interroger. C’est aussi un hypersensible, perméable à la fébrilité de sa mère, qu’il ne sait comment aider.
Ernest, le cadet, a un parcours quasi-inverse.
Ernest porte lui aussi beaucoup de choses sur les épaules. Il semble plus solide que Jean, mais peut-être que dans le fond, il n’est pas si solide… Lui aussi a traversé une phase difficile. Il se pose aussi des questions sur son identité. On lui dit même à un moment : « la dépression, c’est pas pour nous. Tu as trop traîné avec les Blancs ». Mais de quelle couleur se sent Ernest réellement ? Parfois une mélancolie se transmet, une tristesse court entre les générations, et les plus petits en sont le réceptacle sans parvenir à bien le cerner.
Cette question de l’identité et de la couleur de peau est fondamentale dans votre film.
Disons qu’elle traverse le film. La question du « pays » aussi. C’est vrai, cela m’intéressait beaucoup en partant dans l’écriture. Être noir, être né ailleurs, être français, et ne se ressentir ni blanc ni noir, ou les deux, ou encore ne se retrouver nulle part ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Ce sont des questions qui font partie de mon quotidien, ma fille aînée a 5 ans et déjà tout cela la questionne. Je n’ai pas toutes les réponses à lui apporter alors je cherche comme je peux.
Vous montrez aussi qu’il y a des conflits, des tensions parmi les Franco-Africains, qu’ils ne font pas toujours bloc contrairement à ce que voudrait faire croire le communautarisme… ou le racisme.
Bien sûr, parce qu’il y a de la complexité partout. C’était très important de montrer ces scènes de tension. Beaucoup de comédiennes pendant le casting m’ont raconté des anecdotes de ce genre où elles étaient mal acceptées par leurs famille ou amis. Non, tout n’est pas facile. Quand elle arrive en France, Rose a besoin de construire les choses à sa façon, elle est un électron libre, une figure d’insoumission.
Le récit de Un Petit frère est très ample, mais il me semble que la mise en scène vise au contraire une certaine sobriété. Comment l’avez-vous pensée ?
L’écriture est un long processus un peu fou dans lequel tout doit être très maîtrisé. Alors dans la mise en scène, je cherche l’inverse, le lâcher-prise. Je suis plutôt instinctive en ce qui concerne la réalisation. Faire un film c’est préparer des surgissements, mais lesquels ? Au moins j’en sais, au mieux je me porte.
Mais sur ce film, il y avait beaucoup de décors, plusieurs époques, pas mal de contraintes inhérentes. Il a fallu beaucoup plus anticiper que Jeune femme. Alors le travail, c’était de préparer le terrain pour pouvoir faire les choses le plus librement possible. J’avais du temps, et une incroyable Directrice de la Photographie qui a tout de suite compris comment je fonctionnais et qui a sans cesse œuvré pour que le film puisse trouver son souffle au maximum. On a essayé de varier les énergies et les dispositifs, pour créer des sensations différentes. Le film a trois parties mais ce ne sont pas trois courts-métrages, il fallait également trouver le glissement dans le rendu de l’époque, qui soit invisible et élégant, « organique ».
Votre cheffe opératrice est Hélène Louvart, une star du métier qui a travaillé avec Christophe Honoré, Agnès Varda, Wim Wenders, Nicolas Klotz, Alain Guiraudie, Maggie Gyllenhaall…
Hélène fait partie des personnes les plus extraordinaires que j’ai pu rencontrer en vrai. Elle est caméléon, à la fois traductrice (de mon fouillis mental) et interprète d’une histoire et de personnages. Ils semblent gravés en elle une fois pour toute et ne plus jamais la quitter. Cela rend la collaboration passionnante car à partir de là tout ce qu’elle fait est habité.
J’ai énormément appris à ses côtés et je crois que notre dialogue a été fondamental pour traverser le temps dans le film. Il fallait trouver une cadence, un souffle romanesque. À chaque début d’idée, Hélène me suggérait de la pousser toujours plus, ce qui donnait l’impression que tout était possible, tout le temps. On a cherché à varier les dispositifs, à ne jamais laisser s’installer une routine, à créer des rythmes. C’était intuitif et libre. On ne gardait l’épaule que pour certaines scènes plus « documentaires » avec les enfants notamment, et pour certaines scènes isolées. On a pris le temps de poser plus les choses avec des chorégraphies et des mouvements invisibles. Il y avait aussi cette obsession qui était nôtre : mettre ces personnages dans un écrin différent, quitter le gris et le bitume, leur offrir de l’air, du ciel, du vert, de la douceur.
Avec les comédiens, qu’ils soient professionnels ou non, j’ai procédé comme avec Jeune femme, avec le confort d’avoir plus de temps : on prépare en amont mais on ne verrouille rien. On invente, on cherche ensemble, à l’instinct.
Parfois je décidais certaines choses très importantes la veille ou le matin même, mais ce suspens de tous les jours était crucial pour moi. Je serais incapable de tourner fidèlement un storyboard, j’ai besoin que ce soit un peu chaotique pour que cela ressemble à la vie que je trouve très chaotique. Mais cette façon de faire ne peut fonctionner que si toute l’équipe a envie de ça. J’ai été très bien entourée.
Annabelle Langronne qui joue Rose est une formidable découverte.
La rencontre m’a marquée. Le rôle semblait très important pour elle et ça m’importait. Quand on n’est pas tout seul à choisir mais que le rôle semble être très attendu aussi en face, la discussion est riche, moins déséquilibrée. Annabelle avait la carrure pour incarner Rose à différents âges, et un mélange singulier de force, de grâce. Je lui ai proposé plusieurs morceaux de musique pour choisir un titre préféré du personnage, et elle en a apporté un autre, qui lui semblait être plus celui de Rose.
Dès le premier essai elle était déjà dans le film. Son point de vue, son regard étaient précieux, toujours justes. Sur le plateau, on pouvait tout faire, tout tenter ensemble.
Elle est précise et extrêmement inventive. Il y a en elle à la fois la légèreté et le tragique. Et c’est rare, je trouve.
Stéphane Bak joue Jean à 20 ans. On l’a déjà vu dans plusieurs rôles et c’est la première fois qu’il joue de façon aussi intériorisée.
Youna de Peretti, la directrice de casting, a eu la parfaite intuition de me faire rencontrer Stéphane. C’est est un cérébral, il cogite beaucoup, il travaille beaucoup, il est têtu, il aime débattre et le fait avec intelligence et personnalité. Il m’a fait penser au Jean enfant que j’avais écrit au scénario. Il y a aussi quelque chose de l’enfance très ancrée en lui, il est ouvert, et lumineux, passionné et talentueux.
Il semblait connaitre Jean, et m’en a parlé avec acuité, conscient de ce qu’il fallait jouer. Il avait du recul sur son personnage et cette histoire. La rencontre entre Stéphane et Annabelle a permis de commencer à construire cette famille. Il y a une sorte d’équilibre des forces entre eux, c’est palpable dans l’air.
Et Ahmed ?
Ahmed était dans un registre inhabituel en tournant ce projet - c’est ce qu’il m’a dit. Je crois qu’on était tous les deux surpris de travailler l’un avec l’autre. Et j’ai trouvé cela très réjouissant ! C’est quelqu’un d’une grande sensibilité, un acteur à la fois émotif et très technique, alors il s’est glissé dans le film avec beaucoup de finesse et de naturel. J’en ai été assez stupéfaite, je dois dire. Il n’a pas tant de scènes que cela, mais il a emmené le personnage plus loin que je ne l’espérais, de toute évidence, avec une générosité à l’égard du film et des autres comédiens, en particulier avec les non-professionnels.
(Dossier de presse)