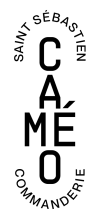Chevalier noir
Entretien avec Emad Aleebrahim Dehkordi, réalisateur
Le titre de Chevalier Noir (A Tale of Shemroon) lui confère une notion de conte. En quoi le film est-il lié à cette forme de récit ?
J'ai commencé à écrire le scénario en 2012. À cette époque, je m’intéressais beaucoup à la mythologie perse (Le Shahanâmé - Le Livre des Rois). Un jour, alors que je vivais déjà à Paris, ma mère m’a appelé pour me raconter une histoire vraie qui venait d’avoir lieu dans mon quartier du nord de Téhéran et qui avait impliqué certains de mes amis, une histoire de revanche ratée. Cette histoire m’a bouleversé, j’ai été frappé par sa violence abrupte et son potentiel tragique. Sa résonance avec des histoires narrées dans la mythologie iranienne m'a sauté aux yeux : on y trouve beaucoup de récits de revanche et d’héritage. On y explore les liens complexes entre père et fils, entre frères, mais aussi des histoires d’amour qui viennent bouleverser les destins. J’y ai vu la possibilité de raconter une histoire très contemporaine, ultra-réelle, avec les codes narratifs du conte persan. Ces deux frères sont des chevaliers qui doivent défendre un territoire, la moto n’est qu’un destrier maudit. Et le quartier de Shemroon, où a été tourné le film et qui surplombe Téhéran, ressemble à une citadelle, une sorte de château-fort…
Chevalier Noir entretient plus pleinement un lien avec une forme classique, celle de la tragédie. Elle est comme une présence permanente, par des signes annonciateurs, comme cet accident causé par un oiseau...
Comme Téhéran s’élargit énormément, la présence de gros oiseaux est de plus en plus importante, je ne sais pas par quel phénomène. J’ai étrangement entendu beaucoup d’anecdotes impliquant des oiseaux lors de mes séjours à Téhéran pendant l'écriture.
Je ne sais pas si j'étais à l'affût de signes symboliques, mais ça m'a rapidement frappé, et j'ai donc décidé de l'intégrer au scénario, d'autant plus que dans la culture perse, le Simorgh est un symbole de prospérité. C’est un oiseau mythique, une figure protectrice et bénéfique. Dans le film, cette figure est mise à mal, annonçant ainsi le destin tragique du héros et du monde qui l’entoure. Le personnage principal est hanté par cet accident mais il a du mal à en interpréter les signes.
Cette idée de symbolique, de forces surnaturelles qui guideraient des personnages était déjà présente dans vos courts métrages, Lower Heaven, Cavalière, Phill 1390. D'où vient-elle ?
Je sais qu'elle est là, mais sans être pourtant un choix conscient. Dans Lower Heaven, par exemple, il y a un serpent, animal symbolique s'il en est, mais sa présence n'était pas prévue dans le scénario. Comme nous tournions dans un endroit où il y avait des serpents, on a pourtant décidé d’en intégrer un dans le film. Je travaille à partir du réel, mais dans cette matière, il y a souvent des éléments qui portent cette force symbolique, et qu’on peut interpréter comme des figures surnaturelles. Même si j'aime les films naturalistes par-dessus tout, je pense que ces symboles prolongent le naturalisme. Ils lui apportent une autre dimension.
Chevalier Noir parle donc d'un contexte iranien, mais vous en avez eu l'idée alors que vous viviez en France depuis plusieurs années. Est-ce que ça été un avantage ou un poids ? Écrit-on plus facilement sur son pays quand on en est éloigné ?
Oui et non. Pour écrire ce scénario, cela m’a aidé d’être éloigné.
Lorsque ma mère m'a raconté ce qui était arrivé à mes deux amis, je me suis mis à imaginer les corollaires possibles afin de créer une fiction autour de ce fait réel. Ensuite, je me suis rendu à Téhéran, où j’ai affiné le scénario avec le ressenti que j’avais là-bas. Si j’avais vécu cette histoire de près, ça m’aurait peut-être impacté différemment, et je n'aurais sans doute pas eu le recul nécessaire pour tisser les fils d'un scénario.
Mais Téhéran est une ville en mouvement permanent et il faut savoir s’adapter. J’ai commencé à écrire il y a dix ans. Depuis, Téhéran s’est complètement transformée. Mon quartier est méconnaissable. J’ai donc dû réadapter le scénario à chaque fois que j’y suis allé.
À l'inverse, j'ai récemment pris conscience que j'ai désormais vécu autant en France qu'en Iran : je pense que cela a influencé ma cinéphilie et développé chez moi un regard nourri autant par le cinéma iranien qu’occidental. Mais je n'ai rien oublié de mon pays et je connais parfaitement sa situation. Les gens en Iran voient bien que je parle de leur réalité. Lorsque je fais un film, c’est d’abord pour eux, et je n’ai pas besoin d’être explicatif dans ma façon de montrer le pays. En revanche, à l’international, je sais que la manière dont je le filme peut étonner et pour certains, ça manque un peu d’« exotisme ». Mais c’est quelque chose que je revendique.
Vous parliez de votre cinéphilie. Chevalier Noir s'approche beaucoup de certains genres : son atmosphère effleure parfois le fantastique, son intrigue est, elle, très proche des codes du film noir. Est-ce que ce sont des influences ?
Bien sûr, il y des influences inconscientes. Le fait qu’Iman soit un anti-héros lui confère les caractéristiques d’un personnage de film noir. Mais curieusement, si je devais rapprocher Chevalier Noir d'un genre, ce serait l’animation, même si ce n’est pas évident à déceler dans le film. Cela tient sans doute aux réminiscences de mon enfance. J’ai baigné dans la diffusion de séries animées de la télévision iranienne des années 80-90. Cela m’a donné la liberté d’ajouter quelques éléments moins naturalistes et plus ludiques au film. On a créé tous les accessoires dans cet esprit : la veste de moto, le casque, l’épée, le bouclier… On s’est amusé comme des enfants avec des jouets.
Par ailleurs, j’ai tenté, avec mon frère et un ami, qui sont peintres, de storyboarder le film. Cela a peu servi pendant le tournage, mais le story board ressemble à une bande-dessinée dont le style, le graphisme et les couleurs ont influencé le style du film en général.
Ce qui ramène à vos études : vous avez été élève de l'école du Fresnoy, Studio national des arts contemporains. Il en reste des choses dans la part sensorielle de la mise en scène de Chevalier Noir, alors que sa trame est, elle, dans une forme plus classique. Comment les deux ont-ils cohabité ?
Au Fresnoy, j’ai eu l’occasion de tester différents médiums, parmi lesquels l’animation en images de synthèse et l’installation vidéo. Cela m'a aidé à trouver un équilibre pour ce film même si ça n'a pas toujours été facile. Dans un premier temps, j’ai même failli aller vers quelque chose de plus expérimental. Finalement, c’est l’histoire elle-même qui m’a imposé la forme du film. J’avais besoin d’être proche du fait divers, et j’ai donc utilisé beaucoup de plans séquences au moment du tournage, même si certains ont été coupés au montage. Ensuite, j’ai adapté la forme aux personnages : les séquences avec Iman sont davantage dans le mouvement, l'immersif, celles avec Payar sont plus posées. Ça s'est fait de manière organique avant d'être construit au montage, mais ça rendait évident que ces deux personnages, en dépit de leurs caractères opposés, sont les deux faces d'une même pièce. Le jeu des deux comédiens, qui ont des méthodes très différentes, m'a aussi beaucoup aidé à aller dans cette direction.
Cette idée de dualité se retrouve aussi dans les choix esthétiques de Chevalier Noir, dans votre façon de filmer la ville qui est présente sans qu’on ait l’impression d’une visite touristique.
Oui, cette sensation vient aussi du moment où l'on a tourné : au plus haut de la pandémie de Covid. Il y avait une sorte d'inconnu, d'incertitude qui flottait dans l'air. On avait même peur de rester ensemble pour tourner. En un sens, on était aussi coincés, cloîtrés, que les personnages le sont. On ne pouvait pas filmer la ville dans le détail car tout faisait référence au Covid : la plupart des magasins et restaurants était fermés et les gens portaient le masque. J’ai donc décidé de me servir de cette contrainte et de plonger mes personnages dans une ville qu’on voit peu pour donner une sensation de claustrophobie. Mais lorsqu’on voit la ville, elle est face à nous, en grand, presque sur-présente. Cela crée un contraste. Lorsqu’on tourne au nord de Téhéran, dans ce quartier, on fait face à la ville, comme dans un duel, mais lorsque on plonge dans la ville, alors on s’immerge et on ne la voit plus, elle est alors hors-champ, et ce qu’on capte, c’est surtout son énergie.
La société iranienne est aussi très incarnée par ces deux frères comme par les personnages qui gravitent autour…
C’est aussi le portrait d’une certaine jeunesse, de cette période de la vie où il faut sortir de chez soi et faire face à la société, sa réalité, sa violence et ses surprises. Il ne s’agit que d’une semaine de la vie de deux frères, mais c’est une semaine à travers laquelle existent toutes les années passées, l’Iran des ruptures, l’écart social, les richesses nouvellement acquises et les abus qu’elles provoquent, mais aussi la décadence de l’ancienne bour- geoisie. Tout cela accentué par l’embargo qui pousse la population à bout, et un système qui ne fonctionne plus. Quand je filme un personnage en manque d’argent dans un quartier riche alors que la réalité écono- mique du pays va mal, c’est aussi pour mettre en avant la violence de cet écart, les valeurs qui se sont renver- sées pour en lâcher certains en route et enrichir les autres. Téhéran est une ville en perpétuelle transition qui demande concession sur concession si l’on veut rester debout. Le père d’Iman et Payar n’a pas su s’adapter, et la société n’a plus rien à offrir à ses enfants. À Téhéran, tout peut basculer d’un coup.
Pour revenir à cette galerie de personnages, plusieurs sont fondamentaux tout en étant moins présents qu'Iman et Payar. Je pense par exemple à leur père, qui reste furtif mais a une réelle ampleur...
En réalité, le personnage du père est surtout né de l'absence de la mère.
Comme je vous l'ai dit, l!histoire est inspirée par des vraies gens autour de moi, notamment deux frères qui vivaient seuls avec leur mère au moment du fait divers. Leur père était absent. Mais j'ai rapidement dû changer cela dans le scénario car je me suis confronté à l'impossibilité de montrer l'intimité d'une mère avec ses garçons à cause de la censure. Dans le milieu que je mets en scène, les femmes ne portent pas de foulard chez elles, or j'aurais été obligé de la filmer avec un foulard. Je ne pouvais pas croire à cela. J'ai donc renversé la situation, et l'absence de la mère est devenue le catalyseur de la crise qui éclate dans la cellule familiale. C’est le même problème pour les autres personnages féminins. Lorsque je filme Hanna, elle est soit en train de sortir et a déjà mis son foulard, soit entre deux portes avec sa capuche. Cela rend le port du foulard imposé par la censure plus réaliste, même si ça complique quand même la mise en scène et demande des concessions.
Ce n'est par ailleurs pas simple de filmer la jeunesse à Téhéran, de mettre en scène le monde de la nuit en suivant les règles de la censure. Il faut rester en équilibre sur une ligne très fine. C’est pour cette raison qu’on ne voit pas de films sur ce milieu-là, et il faut réussir à trouver une forme à la frontière du réalisme et des règles imposées en Iran.
Mais pour en revenir au père, quand j'ai commencé à chercher un acteur pour ce rôle, je me suis rendu compte qu'on retrouve quasiment toujours les trois mêmes acteurs dans le cinéma iranien. J'ai donc cherché d'autres comédiens. Certains se sont fâchés à la lecture du scénario. Ils étaient offusqués par la prétendue passivité de ce personnage. Or, je le vois à l'inverse comme quelqu'un qui se réveille d'un coup à la mort de sa femme, puis une nouvelle fois lorsqu’il est obligé d’arrêter l’opium à cause d’un souci de santé. Lorsqu’on m’a pré- senté Behzad Dorani - auquel je n’avais pas pensé car dans ma tête il serait éternellement le personnage jeune du Vent nous emportera de Kiarostami-, j’ai trouvé qu’il correspondait parfaitement au personnage et qu’il ressemblait physiquement à Iman. Que la figure du père déchu dans mon film soit ce héros du film de Kiarostami est symboliquement important pour moi. Cela raconte quelque chose de notre histoire. La figure de Kiarostami est d'autant plus présente dans mon film que la longue scène de voiture entre Hanna et Payar a été tournée, par hasard, dans son propre 4x4. Son fils partageait son bureau avec notre directeur de production, et alors qu'on galérait pour trouver un véhicule, il a généreusement proposé qu'on l'utilise.
Justement, Hanna, est l'autre personnage secondaire clé du film. Elle y apparaît tardivement mais a une réelle importance, jusqu'à amener, par sa relation avec Payar, Chevalier Noir sur le terrain du romantisme.
Hanna est un personnage libre, énergique, moderne. Elle est représentative de toute une génération de femmes en Iran.
Elle est aussi mon pendant féminin : elle n'est de retour à Téhéran que pour les vacances et devra en repartir pour faire sa vie ailleurs. Plus le personnage d'Hanna s'est écrit, plus je me suis mis à l’aimer, y compris dans cette forme d'histoire parallèle à celle d'Iman et Payar, même si elle n'est que fugitive. J'aime les récits sus- pendus, j’aime les arrêter avant qu'ils ne déclinent.
À mes yeux, Hanna, mais aussi Rouzbeh, l'ami d'Iman, ont une place cruciale dans Chevalier Noir : c'est un film qui parle beaucoup du poids du destin, et ils interviennent tous les deux comme des éléments extérieurs qui vont transformer les vies de ces deux frères.
Chevalier Noir aurait pu s'achever sur une note tragique, mais vous avez fait le choix d'un post- scriptum aux airs de nouveaux horizons pour Iman et Payar.
La logique de la structure des tragédies classiques aurait effectivement dû mener vers une fin bouclant les évènements. Je n'ai pas voulu aller dans cette direction, j’ai voulu garder espoir…
Mais si vous regardez bien cet épilogue, il est en fait à la fois ironique et mélancolique, et le futur d'Iman et Payar reste, malgré tout, incertain à la fin du film…
(Dossier de presse)